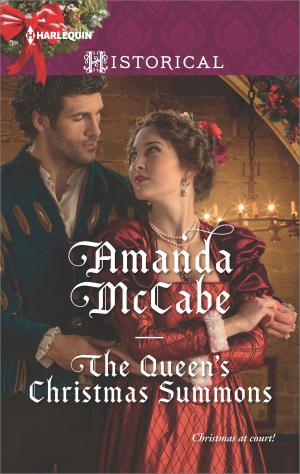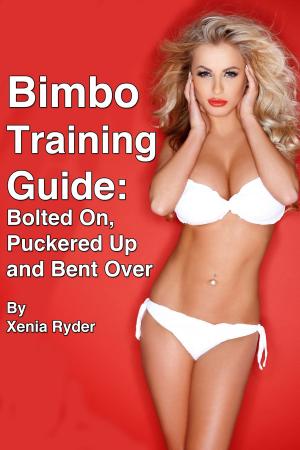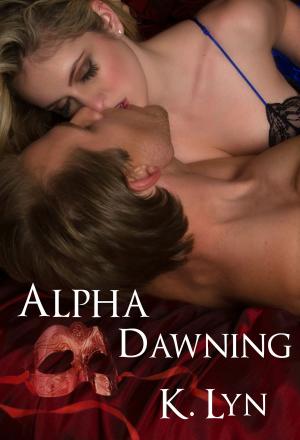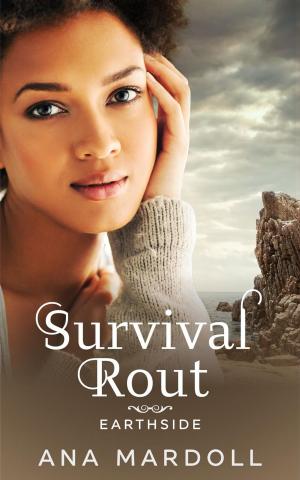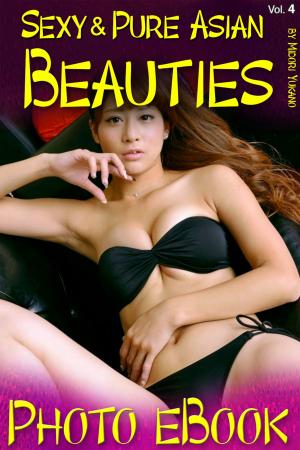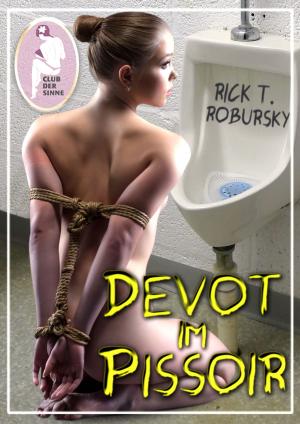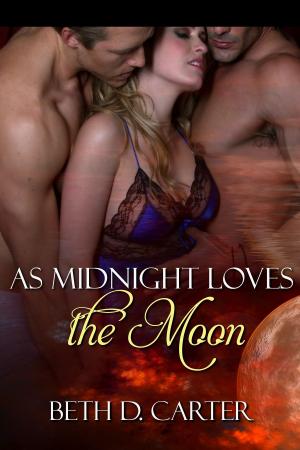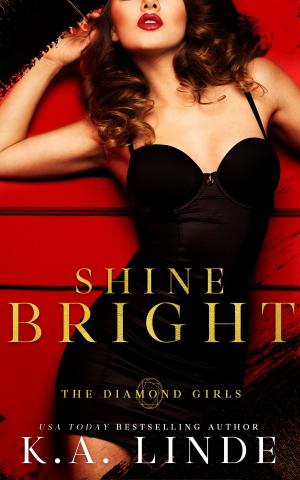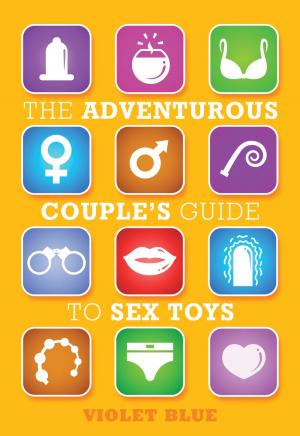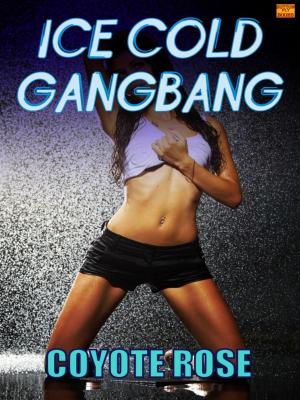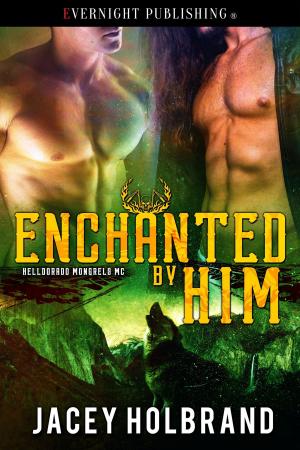| Author: | Octave Feuillet | ISBN: | 1230003148457 |
| Publisher: | Paris : Calmann Lévy, 1890 | Publication: | March 23, 2019 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | Octave Feuillet |
| ISBN: | 1230003148457 |
| Publisher: | Paris : Calmann Lévy, 1890 |
| Publication: | March 23, 2019 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Un des noms les plus nobles de la vieille France, celui des Odon de Pierrepont, était porté, et bien porté, vers 1875, par le marquis Pierre-Armand, dernier descendant mâle de sa famille, qui était alors âgé d’une trentaine d’années. C’était un homme dont les traits charmants et sérieux, la grâce virile, l’élégance correcte et tranquille, évoquaient naturellement cette formule d’admiration banale : il a l’air d’un prince. – Il était difficile, en effet, de se le figurer assis dans un bureau, mesurant de la soie dans un magasin ou exerçant un métier quelconque, si ce n’est celui de diplomate ou de soldat, qui sont deux métiers de prince. On avait vu, du reste, le marquis de Pierrepont sous l’uniforme pendant la guerre de 1870. Il y avait fait preuve du plus brillant courage : puis il était rentré paisiblement dans sa vie de Parisien et de dilettante, un peu par goût et par défaut d’ambition, un peu aussi par complaisance pour une tante qu’il avait et qui n’aimait pas la république.
Cette tante, la baronne de Montauron, née Odon de Pierrepont et plus que fière de sa naissance, était veuve : elle n’avait pas d’enfants et elle n’en était pas fâchée, cette circonstance devant lui permettre de disposer en faveur de son neveu des biens considérables qu’elle tenait de son mari : elle relèverait ainsi la fortune et l’éclat un peu obscurcis de la maison. Les Pierrepont, sans être précisément ruinés, étaient tombés, en effet, depuis deux générations, dans une situation qu’on pouvait appeler médiocre, au prix actuel de la vie. Le jeune marquis n’avait retiré de la succession de son père que quinze ou dix-huit mille francs de rente : c’était assez pour assurer son indépendance ; mais, même avec le léger supplément que sa tante y ajoutait en guise d’étrennes, c’était peu de chose pour un homme de son nom, représentant d’une famille de grands seigneurs. Madame de Montauron, qui avait elle-même un revenu de près de quatre cent mille francs, aurait pu, sans doute, ne pas attendre l’heure de sa mort pour redorer le blason de son neveu ; mais s’il y avait chez elle une passion plus forte que l’orgueil de race, c’était l’égoïsme. Tout en souffrant dans sa fierté de la vie un peu étroite du jeune marquis, elle ne pouvait prendre sur elle de l’améliorer de son vivant en faisant le moindre retranchement à son aisance personnelle. Elle avait alors cinquante-cinq ans. Calculant ses chances d’après certaines statistiques mortuaires empruntées à ses ascendants, elle comptait qu’elle avait encore, en moyenne, une trentaine d’années à vivre. L’humiliation de voir le dernier mâle de son nom réduit à une sorte de gêne pendant un si long espace de temps lui était extrêmement pénible ; mais la pensée de vendre son hôtel de la rue de Varenne ou son château des Genêts, ou n’importe quoi, pour lui venir en aide, lui était encore plus insupportable. Pour concilier ces sentiments contradictoires et pour enrichir son neveu sans se dépouiller elle-même, le seul expédient possible était de lui faire épouser une belle dot. Tel était le but que poursuivait ardemment madame de Montauron au moment où commence cette histoire.
Un des noms les plus nobles de la vieille France, celui des Odon de Pierrepont, était porté, et bien porté, vers 1875, par le marquis Pierre-Armand, dernier descendant mâle de sa famille, qui était alors âgé d’une trentaine d’années. C’était un homme dont les traits charmants et sérieux, la grâce virile, l’élégance correcte et tranquille, évoquaient naturellement cette formule d’admiration banale : il a l’air d’un prince. – Il était difficile, en effet, de se le figurer assis dans un bureau, mesurant de la soie dans un magasin ou exerçant un métier quelconque, si ce n’est celui de diplomate ou de soldat, qui sont deux métiers de prince. On avait vu, du reste, le marquis de Pierrepont sous l’uniforme pendant la guerre de 1870. Il y avait fait preuve du plus brillant courage : puis il était rentré paisiblement dans sa vie de Parisien et de dilettante, un peu par goût et par défaut d’ambition, un peu aussi par complaisance pour une tante qu’il avait et qui n’aimait pas la république.
Cette tante, la baronne de Montauron, née Odon de Pierrepont et plus que fière de sa naissance, était veuve : elle n’avait pas d’enfants et elle n’en était pas fâchée, cette circonstance devant lui permettre de disposer en faveur de son neveu des biens considérables qu’elle tenait de son mari : elle relèverait ainsi la fortune et l’éclat un peu obscurcis de la maison. Les Pierrepont, sans être précisément ruinés, étaient tombés, en effet, depuis deux générations, dans une situation qu’on pouvait appeler médiocre, au prix actuel de la vie. Le jeune marquis n’avait retiré de la succession de son père que quinze ou dix-huit mille francs de rente : c’était assez pour assurer son indépendance ; mais, même avec le léger supplément que sa tante y ajoutait en guise d’étrennes, c’était peu de chose pour un homme de son nom, représentant d’une famille de grands seigneurs. Madame de Montauron, qui avait elle-même un revenu de près de quatre cent mille francs, aurait pu, sans doute, ne pas attendre l’heure de sa mort pour redorer le blason de son neveu ; mais s’il y avait chez elle une passion plus forte que l’orgueil de race, c’était l’égoïsme. Tout en souffrant dans sa fierté de la vie un peu étroite du jeune marquis, elle ne pouvait prendre sur elle de l’améliorer de son vivant en faisant le moindre retranchement à son aisance personnelle. Elle avait alors cinquante-cinq ans. Calculant ses chances d’après certaines statistiques mortuaires empruntées à ses ascendants, elle comptait qu’elle avait encore, en moyenne, une trentaine d’années à vivre. L’humiliation de voir le dernier mâle de son nom réduit à une sorte de gêne pendant un si long espace de temps lui était extrêmement pénible ; mais la pensée de vendre son hôtel de la rue de Varenne ou son château des Genêts, ou n’importe quoi, pour lui venir en aide, lui était encore plus insupportable. Pour concilier ces sentiments contradictoires et pour enrichir son neveu sans se dépouiller elle-même, le seul expédient possible était de lui faire épouser une belle dot. Tel était le but que poursuivait ardemment madame de Montauron au moment où commence cette histoire.