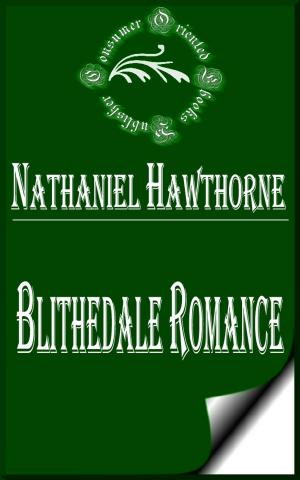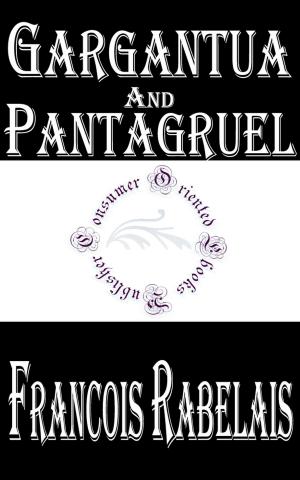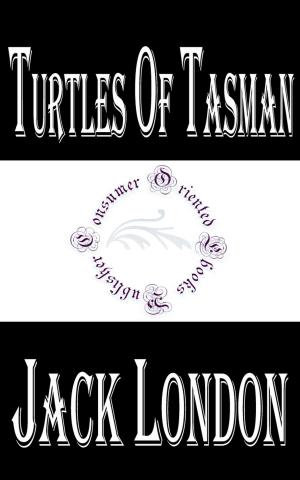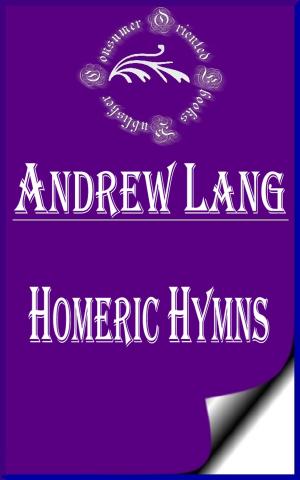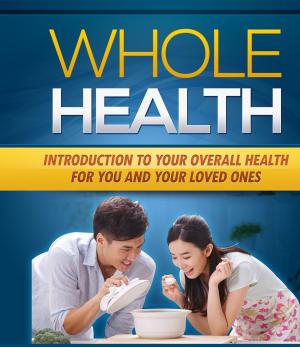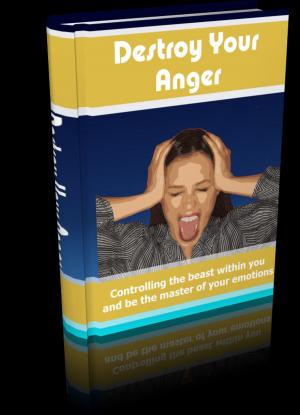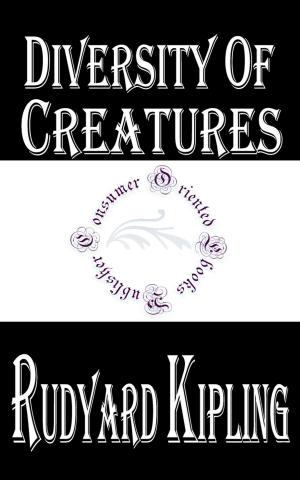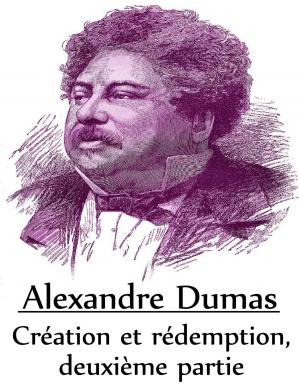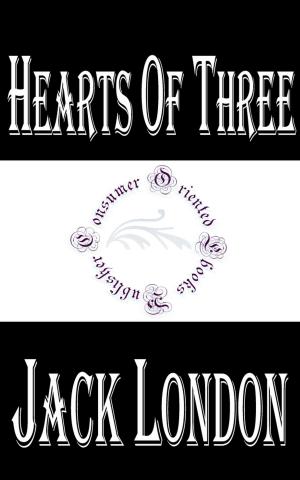| Author: | Jules Verne | ISBN: | 1230000781954 |
| Publisher: | Consumer Oriented Ebooks Publisher | Publication: | November 18, 2015 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | Jules Verne |
| ISBN: | 1230000781954 |
| Publisher: | Consumer Oriented Ebooks Publisher |
| Publication: | November 18, 2015 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Le 18 octobre 1827, vers cinq heures du soir, un petit bâtiment
levantin serrait le vent pour essayer d'atteindre avant la nuit le
port de Vitylo, à l'entrée du golfe de Coron.
Ce port, l'ancien Oetylos d'Homère, est situé dans l'une de ces
trois profondes indentations qui découpent, sur la mer Ionienne et
sur la mer Égée, cette feuille de platane, à laquelle on a très
justement comparé la Grèce méridionale. Sur cette feuille se
développe l'antique Péloponnèse, la Morée de la géographie
moderne. La première de ces dentelures, à l'ouest, c'est le golfe
de Coron, ouvert entre la Messénie et le Magne; la seconde, c'est
le golfe de Marathon, qui échancre largement le littoral de la
sévère Laconie; le troisième, c'est le golfe de Nauplie, dont les
eaux séparent cette Laconie de l'Argolide.
Au premier de ces trois golfes appartient le port de Vitylo.
Creusé à la lisière de sa rive orientale, au fond d'une anse
irrégulière, il occupe les premiers contreforts maritimes du
Taygète, dont le prolongement orographique forme l'ossature de ce
pays du Magne. La sûreté de ses fonds, l'orientation de ses
passes, les hauteurs qui le couvrent, en font l'un des meilleurs
refuges d'une côte incessamment battue par tous les vents de ces
mers méditerranéennes.
Le bâtiment, qui s'élevait, au plus près, contre une assez fraîche
brise de nord-nord-ouest, ne pouvait être visible des quais de
Vitylo. Une distance de six à sept milles l'en séparait encore.
Bien que le temps fût très clair, c'est à peine si la bordure de
ses plus hautes voiles se découpait sur le fond lumineux de
l'extrême horizon.
Mais ce qui ne pouvait se voir d'en bas pouvait se voir d'en haut,
c'est-à-dire du sommet de ces crêtes qui dominent le village.
Vitylo est construit en amphithéâtre sur d'abruptes roches que
défend l'ancienne acropole de Kélapha. Au-dessus se dressent
quelques vieilles tours en ruine, d'une origine postérieure à ces
curieux débris d'un temple de Sérapis, dont les colonnes et les
chapiteaux d'ordre ionique ornent encore l'église de Vitylo. Près
de ces tours s'élèvent aussi deux ou trois petites chapelles peu
fréquentées, desservies par des moines.
Ici, il convient de s'entendre sur ce mot «desservies» et même sur
cette qualification de «moine», appliquée aux caloyers de la côte
messénienne. L'un d'eux, d'ailleurs, qui venait de quitter sa
chapelle, va pouvoir être jugé d'après nature.
À cette époque, la religion, en Grèce, était encore un singulier
mélange des légendes du paganisme et des croyances du
christianisme. Bien des fidèles regardaient les déesses de
l'antiquité comme des saintes de la religion nouvelle.
Actuellement même, ainsi que l'a fait remarquer M. Henry Belle,
«ils amalgament les demi-dieux avec les saints, les farfadets des
vallons enchantés avec les anges du paradis, invoquant aussi bien
les sirènes et les furies que la Panagia». De là, certaines
pratiques bizarres, des anomalies qui font sourire, et, parfois,
un clergé fort empêché de débrouiller ce chaos peu orthodoxe.
Pendant le premier quart de ce siècle, surtout -- il y a quelque
cinquante ans, époque à laquelle s'ouvre cette histoire -- le
clergé de la péninsule hellénique était plus ignorant encore, et
les moines, insouciants, naïfs, familiers, «bons enfants,»
paraissaient assez peu aptes à diriger des populations
naturellement superstitieuses.
Si même ces caloyers n'eussent été qu'ignorants! Mais, en
certaines parties de la Grèce, surtout dans les régions sauvages
du Magne, mendiants par nature et par nécessité, grands
quémandeurs de drachmes que leur jetaient parfois de charitables
voyageurs, n'ayant pour toute occupation que de donner à baiser
aux fidèles quelque apocryphe image de saint ou d'entretenir la
lampe d'une niche de sainte, désespérés du peu de rendement des
dîmes, confessions, enterrements et baptêmes, ces pauvres gens,
recrutés d'ailleurs dans les plus basses classes, ne répugnaient
point à faire le métier de guetteurs -- et quels guetteurs! --
pour le compte des habitants du littoral.
Aussi, les marins de Vitylo, étendus sur le port à la façon de ces
lazzaroni auxquels il faut des heures pour se reposer d'un travail
de quelques minutes, se levèrent-ils, lorsqu'ils virent un de
leurs caloyers descendre rapidement vers le village, en agitant
les bras.
C'était un homme de cinquante à cinquante-cinq ans, non seulement
gros, mais gras de cette graisse que produit l'oisiveté, et dont
la physionomie rusée ne pouvait inspirer qu'une médiocre
confiance.
«Eh! qu'y a-t-il, père, qu'y a-t-il?» s'écria l'un des marins, en
courant vers lui.
Le Vitylien parlait de ce ton nasillard qui ferait croire que
Nason a été un des ancêtres des Hellènes, et dans ce patois
maniote, où le grec, le turc, l'italien et l'albanais se
mélangent, comme s'il eût existé au temps de la tour de Babel.
«Est-ce que les soldats d'Ibrahim ont envahi les hauteurs du
Taygète? demanda un autre marin, en faisant un geste d'insouciance
qui marquait assez peu de patriotisme.
-- À moins que ce ne soient des Français, dont nous n'avons que
faire! répondit le premier interlocuteur.
-- Ils se valent!» répliqua un troisième.
Et cette réponse indiquait combien la lutte, alors dans sa plus
terrible période, n'intéressait que légèrement ces indigènes de
l'extrême Péloponnèse, bien différents des Maniotes du Nord, qui
marquèrent si brillamment dans la guerre de l'Indépendance. Mais
le gros caloyer ne pouvait répliquer ni à l'un ni à l'autre. Il
s'était essoufflé à descendre les rapides rampes de la falaise. Sa
poitrine d'asthmatique haletait. Il voulait parler, il n'y
parvenait pas. Au moins, l'un de ses ancêtres en Hellade, le
soldat de Marathon, avant de tomber mort, avait-il pu prononcer la
victoire de Miltiade. Mais il ne s'agissait plus de Miltiade ni de
la guerre des Athéniens et des Perses. C'étaient à peine des
Grecs, ces farouches habitants de l'extrême pointe du Magne.
«Eh! parle donc, père, parle donc!» s'écria un vieux marin, nommé
Gozzo, plus impatient que les autres, comme s'il eût deviné ce que
venait annoncer le moine.
Celui-ci parvint enfin à reprendre haleine. Puis, tendant la main
vers l'horizon:
«Navire en vue!» dit-il.
Et, sur ces mots, tous les fainéants de se redresser, de battre
des mains, de courir vers un rocher qui dominait le port. De là,
leur regard pouvait embrasser la pleine mer sur un plus vaste
secteur.
Un étranger aurait pu croire que ce mouvement était provoqué par
l'intérêt que tout navire, arrivant du large, doit naturellement
inspirer à des marins fanatiques des choses de la mer. Il n'en
était rien, ou, plutôt, si une question d'intérêt pouvait
passionner ces indigènes, c'était à un point de vue tout spécial.
En effet, au moment où s'écrit -- non au moment où se passait
cette histoire -- le Magne est encore un pays à part au milieu de
la Grèce, redevenue royaume indépendant de par la volonté des
puissances européennes, signataires du traité d'Andrinople de
1829. Les Maniotes, ou tout au moins ceux de ce nom qui vivent sur
ces pointes allongées entre les golfes, sont restés à demi
barbares, plus soucieux de leur liberté propre que de la liberté
de leur pays. Aussi cette langue extrême de la Morée inférieure a-
t-elle été, de tout temps, presque impossible à réduire. Ni les
janissaires turcs, ni les gendarmes grecs n'ont pu en avoir
raison. Querelleurs, vindicatifs, se transmettant, comme les
Corses, des haines de familles, qui ne peuvent s'éteindre que dans
le sang, pillards de naissance et pourtant hospitaliers,
assassins, lorsque le vol exige l'assassinat, ces rudes
montagnards ne s'en disent pas moins les descendants directs des
Spartiates; mais, enfermés dans ces ramifications du Taygète, où
l'on compte par milliers de ces petites citadelles ou «pyrgos»
presque inaccessibles, ils jouent trop volontiers le rôle
équivoque de ces routiers du moyen âge dont les droits féodaux
s'exerçaient à coups de poignard et d'escopette.
Or, si les Maniotes, à l'heure qu'il est, sont encore des demi-
sauvages, il est aisé de s'imaginer ce qu'ils devaient être, il y
a cinquante ans. Avant que les croisières des bâtiments à vapeur
n'eussent singulièrement enrayé leurs déprédations sur mer,
pendant le premier tiers du ce siècle, ce furent bien les plus
déterminés pirates que les navires de commerce pussent redouter
sur toutes les Échelles du Levant.
Et précisément, le port de Vitylo, par sa situation à l'extrémité
du Péloponnèse, à l'entrée de deux mers, par sa proximité de l'île
de Cérigotto, chère aux forbans, était bien placé pour s'ouvrir à
tous ces malfaiteurs qui écumaient l'Archipel et les parages
voisins de la Méditerranée. Le point de concentration des
habitants de cette partie du Magne portait plus spécialement alors
le nom de pays de Kakovonni, et les Kakovonniotes, à cheval sur
cette pointe que termine le cap Matapan, se trouvaient à l'aise
pour opérer. En mer, ils attaquaient les navires. À terre, ils les
attiraient par de faux signaux. Partout, ils les pillaient et les
brûlaient. Que leurs équipages fussent turcs, maltais, égyptiens,
grecs même, peu importait: ils étaient impitoyablement massacrés
ou vendus comme esclaves sur les côtes barbaresques. La besogne
venait-elle à chômer, les caboteurs se faisaient-ils rares dans
les parages du golfe de Coron ou du golfe de Marathon, au large de
Cérigo ou du cap Gallo, des prières publiques montaient vers le
Dieu des tempêtes, afin qu'il daignât mettre au plein quelque
bâtiment de fort tonnage et de riche cargaison. Et les caloyers ne
se refusaient point à ces prières, pour le plus grand profit de
leurs fidèles.
Le 18 octobre 1827, vers cinq heures du soir, un petit bâtiment
levantin serrait le vent pour essayer d'atteindre avant la nuit le
port de Vitylo, à l'entrée du golfe de Coron.
Ce port, l'ancien Oetylos d'Homère, est situé dans l'une de ces
trois profondes indentations qui découpent, sur la mer Ionienne et
sur la mer Égée, cette feuille de platane, à laquelle on a très
justement comparé la Grèce méridionale. Sur cette feuille se
développe l'antique Péloponnèse, la Morée de la géographie
moderne. La première de ces dentelures, à l'ouest, c'est le golfe
de Coron, ouvert entre la Messénie et le Magne; la seconde, c'est
le golfe de Marathon, qui échancre largement le littoral de la
sévère Laconie; le troisième, c'est le golfe de Nauplie, dont les
eaux séparent cette Laconie de l'Argolide.
Au premier de ces trois golfes appartient le port de Vitylo.
Creusé à la lisière de sa rive orientale, au fond d'une anse
irrégulière, il occupe les premiers contreforts maritimes du
Taygète, dont le prolongement orographique forme l'ossature de ce
pays du Magne. La sûreté de ses fonds, l'orientation de ses
passes, les hauteurs qui le couvrent, en font l'un des meilleurs
refuges d'une côte incessamment battue par tous les vents de ces
mers méditerranéennes.
Le bâtiment, qui s'élevait, au plus près, contre une assez fraîche
brise de nord-nord-ouest, ne pouvait être visible des quais de
Vitylo. Une distance de six à sept milles l'en séparait encore.
Bien que le temps fût très clair, c'est à peine si la bordure de
ses plus hautes voiles se découpait sur le fond lumineux de
l'extrême horizon.
Mais ce qui ne pouvait se voir d'en bas pouvait se voir d'en haut,
c'est-à-dire du sommet de ces crêtes qui dominent le village.
Vitylo est construit en amphithéâtre sur d'abruptes roches que
défend l'ancienne acropole de Kélapha. Au-dessus se dressent
quelques vieilles tours en ruine, d'une origine postérieure à ces
curieux débris d'un temple de Sérapis, dont les colonnes et les
chapiteaux d'ordre ionique ornent encore l'église de Vitylo. Près
de ces tours s'élèvent aussi deux ou trois petites chapelles peu
fréquentées, desservies par des moines.
Ici, il convient de s'entendre sur ce mot «desservies» et même sur
cette qualification de «moine», appliquée aux caloyers de la côte
messénienne. L'un d'eux, d'ailleurs, qui venait de quitter sa
chapelle, va pouvoir être jugé d'après nature.
À cette époque, la religion, en Grèce, était encore un singulier
mélange des légendes du paganisme et des croyances du
christianisme. Bien des fidèles regardaient les déesses de
l'antiquité comme des saintes de la religion nouvelle.
Actuellement même, ainsi que l'a fait remarquer M. Henry Belle,
«ils amalgament les demi-dieux avec les saints, les farfadets des
vallons enchantés avec les anges du paradis, invoquant aussi bien
les sirènes et les furies que la Panagia». De là, certaines
pratiques bizarres, des anomalies qui font sourire, et, parfois,
un clergé fort empêché de débrouiller ce chaos peu orthodoxe.
Pendant le premier quart de ce siècle, surtout -- il y a quelque
cinquante ans, époque à laquelle s'ouvre cette histoire -- le
clergé de la péninsule hellénique était plus ignorant encore, et
les moines, insouciants, naïfs, familiers, «bons enfants,»
paraissaient assez peu aptes à diriger des populations
naturellement superstitieuses.
Si même ces caloyers n'eussent été qu'ignorants! Mais, en
certaines parties de la Grèce, surtout dans les régions sauvages
du Magne, mendiants par nature et par nécessité, grands
quémandeurs de drachmes que leur jetaient parfois de charitables
voyageurs, n'ayant pour toute occupation que de donner à baiser
aux fidèles quelque apocryphe image de saint ou d'entretenir la
lampe d'une niche de sainte, désespérés du peu de rendement des
dîmes, confessions, enterrements et baptêmes, ces pauvres gens,
recrutés d'ailleurs dans les plus basses classes, ne répugnaient
point à faire le métier de guetteurs -- et quels guetteurs! --
pour le compte des habitants du littoral.
Aussi, les marins de Vitylo, étendus sur le port à la façon de ces
lazzaroni auxquels il faut des heures pour se reposer d'un travail
de quelques minutes, se levèrent-ils, lorsqu'ils virent un de
leurs caloyers descendre rapidement vers le village, en agitant
les bras.
C'était un homme de cinquante à cinquante-cinq ans, non seulement
gros, mais gras de cette graisse que produit l'oisiveté, et dont
la physionomie rusée ne pouvait inspirer qu'une médiocre
confiance.
«Eh! qu'y a-t-il, père, qu'y a-t-il?» s'écria l'un des marins, en
courant vers lui.
Le Vitylien parlait de ce ton nasillard qui ferait croire que
Nason a été un des ancêtres des Hellènes, et dans ce patois
maniote, où le grec, le turc, l'italien et l'albanais se
mélangent, comme s'il eût existé au temps de la tour de Babel.
«Est-ce que les soldats d'Ibrahim ont envahi les hauteurs du
Taygète? demanda un autre marin, en faisant un geste d'insouciance
qui marquait assez peu de patriotisme.
-- À moins que ce ne soient des Français, dont nous n'avons que
faire! répondit le premier interlocuteur.
-- Ils se valent!» répliqua un troisième.
Et cette réponse indiquait combien la lutte, alors dans sa plus
terrible période, n'intéressait que légèrement ces indigènes de
l'extrême Péloponnèse, bien différents des Maniotes du Nord, qui
marquèrent si brillamment dans la guerre de l'Indépendance. Mais
le gros caloyer ne pouvait répliquer ni à l'un ni à l'autre. Il
s'était essoufflé à descendre les rapides rampes de la falaise. Sa
poitrine d'asthmatique haletait. Il voulait parler, il n'y
parvenait pas. Au moins, l'un de ses ancêtres en Hellade, le
soldat de Marathon, avant de tomber mort, avait-il pu prononcer la
victoire de Miltiade. Mais il ne s'agissait plus de Miltiade ni de
la guerre des Athéniens et des Perses. C'étaient à peine des
Grecs, ces farouches habitants de l'extrême pointe du Magne.
«Eh! parle donc, père, parle donc!» s'écria un vieux marin, nommé
Gozzo, plus impatient que les autres, comme s'il eût deviné ce que
venait annoncer le moine.
Celui-ci parvint enfin à reprendre haleine. Puis, tendant la main
vers l'horizon:
«Navire en vue!» dit-il.
Et, sur ces mots, tous les fainéants de se redresser, de battre
des mains, de courir vers un rocher qui dominait le port. De là,
leur regard pouvait embrasser la pleine mer sur un plus vaste
secteur.
Un étranger aurait pu croire que ce mouvement était provoqué par
l'intérêt que tout navire, arrivant du large, doit naturellement
inspirer à des marins fanatiques des choses de la mer. Il n'en
était rien, ou, plutôt, si une question d'intérêt pouvait
passionner ces indigènes, c'était à un point de vue tout spécial.
En effet, au moment où s'écrit -- non au moment où se passait
cette histoire -- le Magne est encore un pays à part au milieu de
la Grèce, redevenue royaume indépendant de par la volonté des
puissances européennes, signataires du traité d'Andrinople de
1829. Les Maniotes, ou tout au moins ceux de ce nom qui vivent sur
ces pointes allongées entre les golfes, sont restés à demi
barbares, plus soucieux de leur liberté propre que de la liberté
de leur pays. Aussi cette langue extrême de la Morée inférieure a-
t-elle été, de tout temps, presque impossible à réduire. Ni les
janissaires turcs, ni les gendarmes grecs n'ont pu en avoir
raison. Querelleurs, vindicatifs, se transmettant, comme les
Corses, des haines de familles, qui ne peuvent s'éteindre que dans
le sang, pillards de naissance et pourtant hospitaliers,
assassins, lorsque le vol exige l'assassinat, ces rudes
montagnards ne s'en disent pas moins les descendants directs des
Spartiates; mais, enfermés dans ces ramifications du Taygète, où
l'on compte par milliers de ces petites citadelles ou «pyrgos»
presque inaccessibles, ils jouent trop volontiers le rôle
équivoque de ces routiers du moyen âge dont les droits féodaux
s'exerçaient à coups de poignard et d'escopette.
Or, si les Maniotes, à l'heure qu'il est, sont encore des demi-
sauvages, il est aisé de s'imaginer ce qu'ils devaient être, il y
a cinquante ans. Avant que les croisières des bâtiments à vapeur
n'eussent singulièrement enrayé leurs déprédations sur mer,
pendant le premier tiers du ce siècle, ce furent bien les plus
déterminés pirates que les navires de commerce pussent redouter
sur toutes les Échelles du Levant.
Et précisément, le port de Vitylo, par sa situation à l'extrémité
du Péloponnèse, à l'entrée de deux mers, par sa proximité de l'île
de Cérigotto, chère aux forbans, était bien placé pour s'ouvrir à
tous ces malfaiteurs qui écumaient l'Archipel et les parages
voisins de la Méditerranée. Le point de concentration des
habitants de cette partie du Magne portait plus spécialement alors
le nom de pays de Kakovonni, et les Kakovonniotes, à cheval sur
cette pointe que termine le cap Matapan, se trouvaient à l'aise
pour opérer. En mer, ils attaquaient les navires. À terre, ils les
attiraient par de faux signaux. Partout, ils les pillaient et les
brûlaient. Que leurs équipages fussent turcs, maltais, égyptiens,
grecs même, peu importait: ils étaient impitoyablement massacrés
ou vendus comme esclaves sur les côtes barbaresques. La besogne
venait-elle à chômer, les caboteurs se faisaient-ils rares dans
les parages du golfe de Coron ou du golfe de Marathon, au large de
Cérigo ou du cap Gallo, des prières publiques montaient vers le
Dieu des tempêtes, afin qu'il daignât mettre au plein quelque
bâtiment de fort tonnage et de riche cargaison. Et les caloyers ne
se refusaient point à ces prières, pour le plus grand profit de
leurs fidèles.