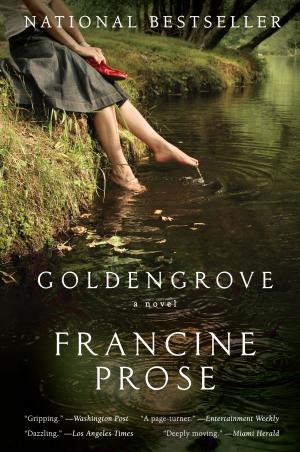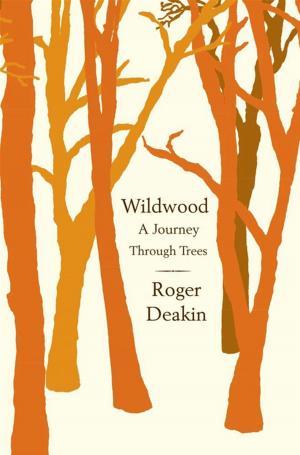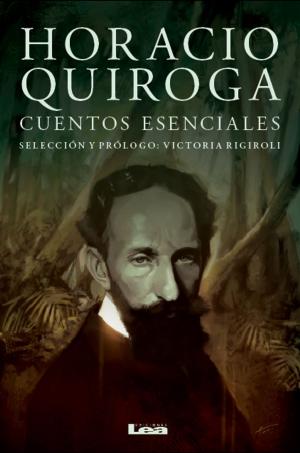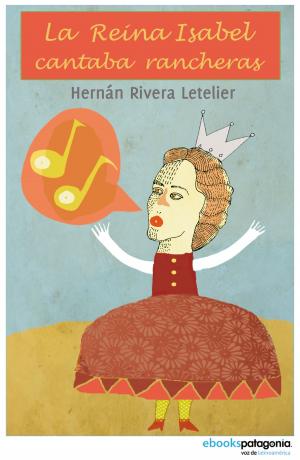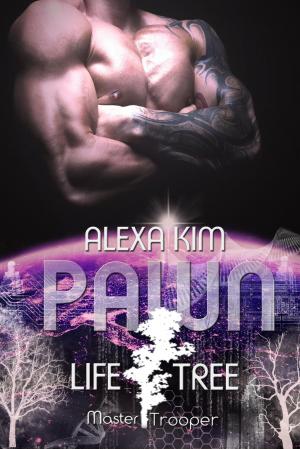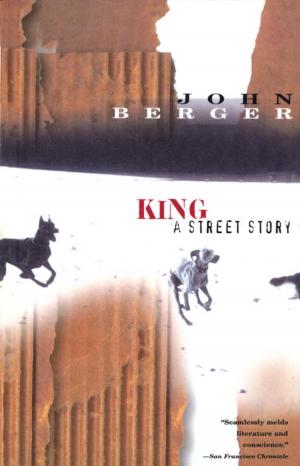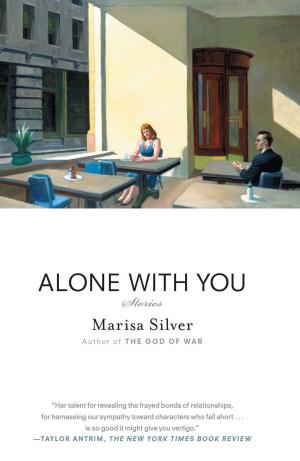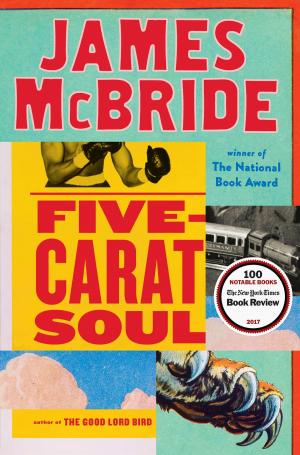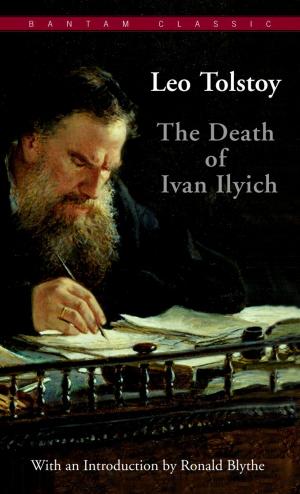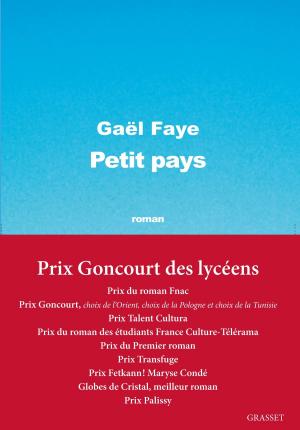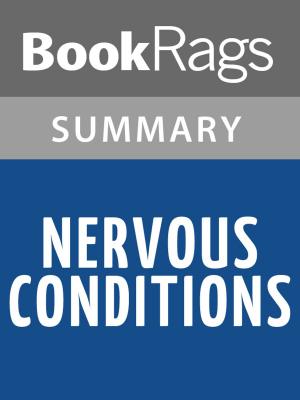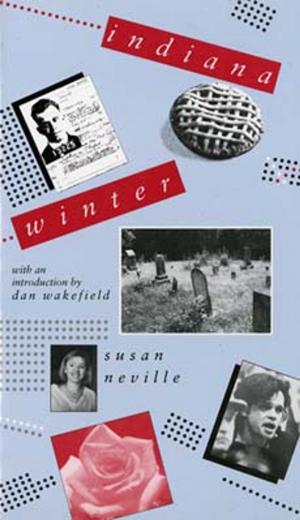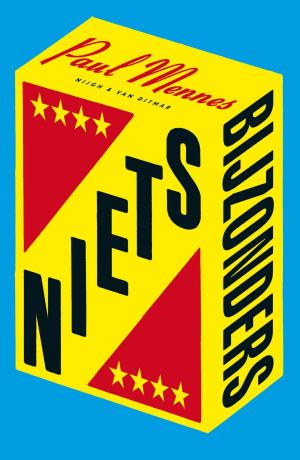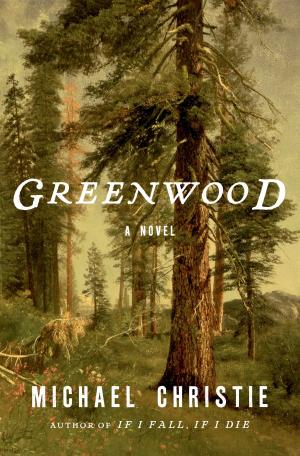Les sept péchés capitaux
( Edition intégrale ) annoté - illustré
Kids, Fiction, Action/Adventure, Fiction & Literature, Religious, Literary| Author: | Eugène Sue | ISBN: | 1230003147047 |
| Publisher: | Paris : J. Rouff, 18.. | Publication: | March 22, 2019 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | Eugène Sue |
| ISBN: | 1230003147047 |
| Publisher: | Paris : J. Rouff, 18.. |
| Publication: | March 22, 2019 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Les péchés capitaux correspondent, dans la tradition chrétienne, aux péchés dont découleraient tous les autres, des « vices » cardinaux établis au nombre de sept. Cette nomenclature remontant au IVe siècle, elle a été ensuite systématisée par Thomas d’Aquin qui distingue : l’acédie, l’orgueil, la gourmandise, la luxure, l’avarice, la colère et l’envie.
Les vices ou les péchés ont été très tôt traités sous forme d’allégorie par les auteurs chrétiens, qui s’inspiraient des allégories antiques (la Discorde telle qu’exprimée chez Homère, la Fortune, la Rumeur) décrites par les poètes grecs ou latins. L’Éthique à Nicomaque d’Aristote met en jeu la philosophie morale, ce texte fondamental circule abondamment dans l’Empire d’Alexandre, puis la République romaine et enfin aux premiers temps de l’Empire romain. Tertullien est un des premiers à opérer cette conversion de la culture antique, suivi par Prudence, dont la Psychomachia sera longtemps une référence en la matière. La littérature allégorique médiévale non seulement reprend ces archétypes des péchés, mais les multiplie à plaisir, dans des œuvres comme le Livre du cœur d’amour épris, 1457) de René d’Anjou, ou le Livre de la Cité des Dames de Christine de Pizan. La Divine Comédie de Dante elle non plus ne se contente pas des sept péchés mais en décline de nombreuses variations dans la première partie, Le Purgatoire. Chaucer charge un curé de les énumérer et de les commenter (« The Parson’s Prologue and Tale ») dans Les Contes de Canterbury.
Au milieu du xixe siècle, Eugène Sue les traite en feuilleton dans Les Sept Péchés capitaux (1847-1852).
L’ORGUEIL
L’ENVIE
LA COLERE
LA LUXURE
LA PARESSE
L’AVARICE
LA GOURMANDISE
La Gourmandise raconte une aventure amoureuse pleine de rebondissements. Mais le récit n’est ici qu’un prétexte car l’intérêt de l’histoire se situe ailleurs, précisément dans une réflexion sur la gastronomie et son usage. La gourmandise n’est un péché mortel que si elle est dévoyée en gloutonnerie. Dans la lignée de la Physiologie du goût exaltée en son temps par Brillat-Savarin, Sue propose une Philosophie du goût perpétuant ainsi un certain esprit français: la cuisine, les terroirs et leurs produits sont un trésor national, et à ce titre, la nourriture est à considérer comme une affaire de la plus haute importance.
Les péchés capitaux correspondent, dans la tradition chrétienne, aux péchés dont découleraient tous les autres, des « vices » cardinaux établis au nombre de sept. Cette nomenclature remontant au IVe siècle, elle a été ensuite systématisée par Thomas d’Aquin qui distingue : l’acédie, l’orgueil, la gourmandise, la luxure, l’avarice, la colère et l’envie.
Les vices ou les péchés ont été très tôt traités sous forme d’allégorie par les auteurs chrétiens, qui s’inspiraient des allégories antiques (la Discorde telle qu’exprimée chez Homère, la Fortune, la Rumeur) décrites par les poètes grecs ou latins. L’Éthique à Nicomaque d’Aristote met en jeu la philosophie morale, ce texte fondamental circule abondamment dans l’Empire d’Alexandre, puis la République romaine et enfin aux premiers temps de l’Empire romain. Tertullien est un des premiers à opérer cette conversion de la culture antique, suivi par Prudence, dont la Psychomachia sera longtemps une référence en la matière. La littérature allégorique médiévale non seulement reprend ces archétypes des péchés, mais les multiplie à plaisir, dans des œuvres comme le Livre du cœur d’amour épris, 1457) de René d’Anjou, ou le Livre de la Cité des Dames de Christine de Pizan. La Divine Comédie de Dante elle non plus ne se contente pas des sept péchés mais en décline de nombreuses variations dans la première partie, Le Purgatoire. Chaucer charge un curé de les énumérer et de les commenter (« The Parson’s Prologue and Tale ») dans Les Contes de Canterbury.
Au milieu du xixe siècle, Eugène Sue les traite en feuilleton dans Les Sept Péchés capitaux (1847-1852).
L’ORGUEIL
L’ENVIE
LA COLERE
LA LUXURE
LA PARESSE
L’AVARICE
LA GOURMANDISE
La Gourmandise raconte une aventure amoureuse pleine de rebondissements. Mais le récit n’est ici qu’un prétexte car l’intérêt de l’histoire se situe ailleurs, précisément dans une réflexion sur la gastronomie et son usage. La gourmandise n’est un péché mortel que si elle est dévoyée en gloutonnerie. Dans la lignée de la Physiologie du goût exaltée en son temps par Brillat-Savarin, Sue propose une Philosophie du goût perpétuant ainsi un certain esprit français: la cuisine, les terroirs et leurs produits sont un trésor national, et à ce titre, la nourriture est à considérer comme une affaire de la plus haute importance.