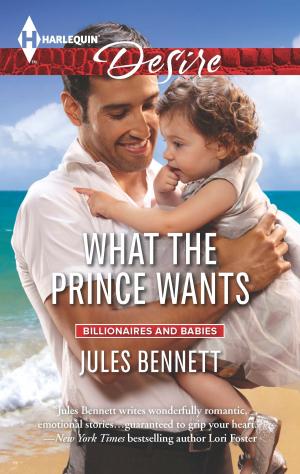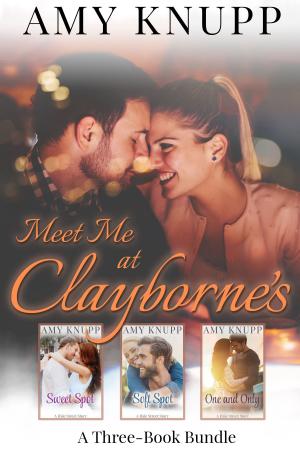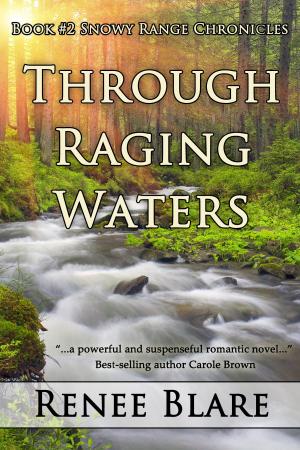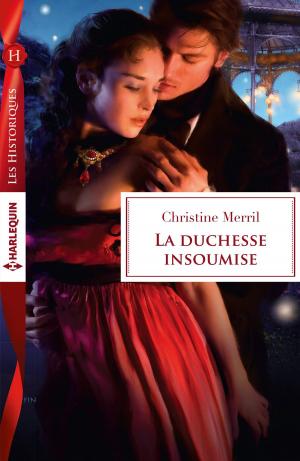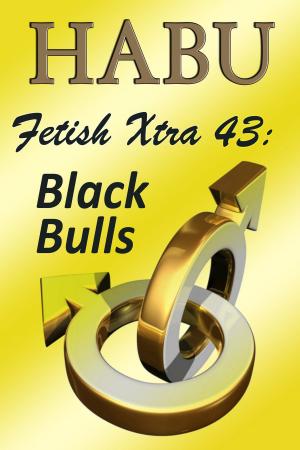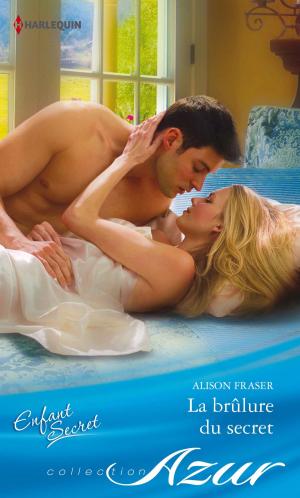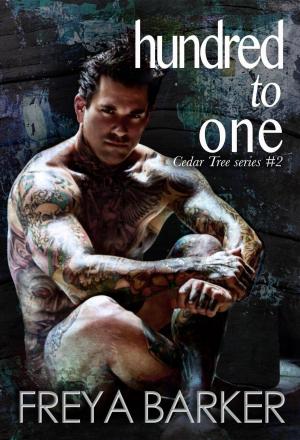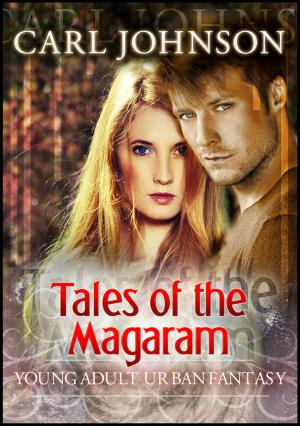Quand j’étais homme
Cahiers d’une femme ( Edition intégrale )
Fiction & Literature, Classics, Literary, Romance| Author: | Camille Lemonnier | ISBN: | 1230003231470 |
| Publisher: | Paris : Louis-Michaud, 1907 | Publication: | May 15, 2019 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | Camille Lemonnier |
| ISBN: | 1230003231470 |
| Publisher: | Paris : Louis-Michaud, 1907 |
| Publication: | May 15, 2019 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Il y avait vingt-ans que mon oncle, César-Napoléon Barboux, le marchand de parapluies, occupait dans le passage la petite boutique à vitrine basse qui venait tout de suite après M. Populaire, le bouquiniste, dont l’étalage dépassait l’alignement et qui vendait aussi des vieux portraits achetés dans les mortuaires. C’était pour ma mère un frère du second lit. Un jour il avait quitté la petite ville où habitait notre famille : il avait débarqué à Paris ; il y avait épousé Jeanne-Adélaïde Roserais, demeurée veuve, avec la petite boutique de parapluies que lui avait laissée son mari. Jeanne Adélaïde étant morte à son tour, du chagrin, disait-on, d’être trop régulièrement suppléée par des passantes dans ses droits légitimes d’épouse, mon oncle continua seul l’industrie demi-séculaire qui avait pour enseigne A la jolie Ombrelle, bien que, depuis une dizaine d’années, on n’y vendît plus que des parapluies. Malheureusement, cette enseigne modeste avait été insuffisante à lutter contre la concurrence que lui fît un beau matin l’ouverture d’un magasin à deux vitrines dans la rue sur laquelle débouchait le passage, avec cette enseigne en grandes lettres d’or : A la Canne de Voltaire. C’était là un commerce complet avec assortiments variés de tous les articles qui n’étaient qu’à demi représentés chez nous,
Chez nous… J’avais dix-sept ans quand la vie me contraignit à venir habiter chez mon oncle Barboux Je puis donc bien dire « chez nous, » puisque je fus là, pendant une couple d’années, aux côtés de ce vieil homme taciturne et renfrogné, une sorte de nièce à tout faire. C’était moi qui ouvrais le magasin au matin, cirais le plancher, époussetais et tenais le ménage. J’avais aussi acquis une certaine adresse à réparer les parapluies malades qu’on nous apportait à raccommoder et qui faisaient d’un coin de la boutique un véritable hôpital de vieux pépins usés d’ans et d’infirmités. Mes points à l’aiguille étaient presque invisibles : on disait dans le quartier : « A-t-il de la chance, ce vieux Barboux, d’avoir mis la main sur un pareil trésor et qui ne lui coûte que la nourriture ! » Même ses plus anciens clients voulaient toujours être servis par moi.
Il y avait vingt-ans que mon oncle, César-Napoléon Barboux, le marchand de parapluies, occupait dans le passage la petite boutique à vitrine basse qui venait tout de suite après M. Populaire, le bouquiniste, dont l’étalage dépassait l’alignement et qui vendait aussi des vieux portraits achetés dans les mortuaires. C’était pour ma mère un frère du second lit. Un jour il avait quitté la petite ville où habitait notre famille : il avait débarqué à Paris ; il y avait épousé Jeanne-Adélaïde Roserais, demeurée veuve, avec la petite boutique de parapluies que lui avait laissée son mari. Jeanne Adélaïde étant morte à son tour, du chagrin, disait-on, d’être trop régulièrement suppléée par des passantes dans ses droits légitimes d’épouse, mon oncle continua seul l’industrie demi-séculaire qui avait pour enseigne A la jolie Ombrelle, bien que, depuis une dizaine d’années, on n’y vendît plus que des parapluies. Malheureusement, cette enseigne modeste avait été insuffisante à lutter contre la concurrence que lui fît un beau matin l’ouverture d’un magasin à deux vitrines dans la rue sur laquelle débouchait le passage, avec cette enseigne en grandes lettres d’or : A la Canne de Voltaire. C’était là un commerce complet avec assortiments variés de tous les articles qui n’étaient qu’à demi représentés chez nous,
Chez nous… J’avais dix-sept ans quand la vie me contraignit à venir habiter chez mon oncle Barboux Je puis donc bien dire « chez nous, » puisque je fus là, pendant une couple d’années, aux côtés de ce vieil homme taciturne et renfrogné, une sorte de nièce à tout faire. C’était moi qui ouvrais le magasin au matin, cirais le plancher, époussetais et tenais le ménage. J’avais aussi acquis une certaine adresse à réparer les parapluies malades qu’on nous apportait à raccommoder et qui faisaient d’un coin de la boutique un véritable hôpital de vieux pépins usés d’ans et d’infirmités. Mes points à l’aiguille étaient presque invisibles : on disait dans le quartier : « A-t-il de la chance, ce vieux Barboux, d’avoir mis la main sur un pareil trésor et qui ne lui coûte que la nourriture ! » Même ses plus anciens clients voulaient toujours être servis par moi.