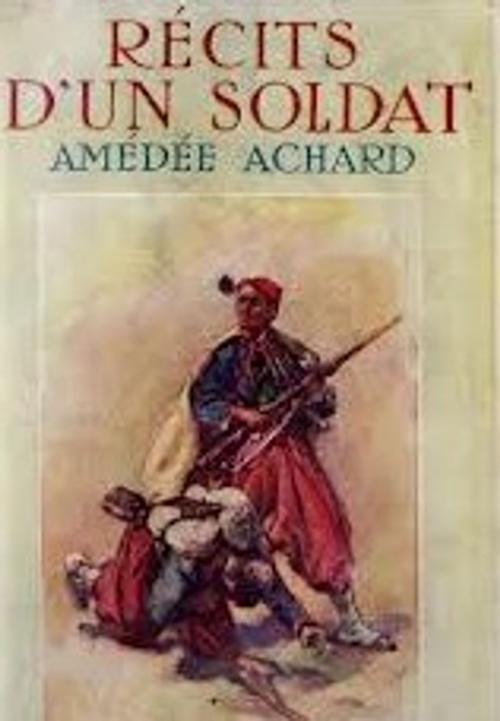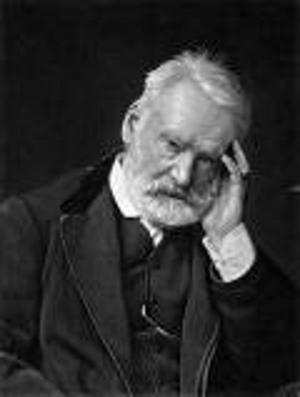| Author: | Amédée ACHARD | ISBN: | 1230000553292 |
| Publisher: | DOMAINE PUBLIC | Publication: | June 18, 2015 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | Amédée ACHARD |
| ISBN: | 1230000553292 |
| Publisher: | DOMAINE PUBLIC |
| Publication: | June 18, 2015 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Au mois de juillet 1870, j’achevais la troisième année de mes études à l’École centrale des arts et manufactures. C’était le moment où la guerre, qui allait être déclarée, remplissait Paris de tumulte et de bruit. Dans nos théâtres, tout un peuple fouetté par les excitations d’une partie de la presse, écoutait debout, en le couvrant d’applaudissements frénétiques, le refrain terrible de cette Marseillaise qui devait nous mener à tant de désastres. Des régiments passaient sur les boulevards, accompagnés par les clameurs de milliers d’oisifs qui croyaient qu’on gagnait des batailles avec des cris. La ritournelle de la chanson des Girondins se promenait par les rues, psalmodiée par la voix des gavroches. Cette agitation factice pouvait faire supposer à un observateur inattentif que la grande ville désirait, appelait la guerre ; le gouvernement, qui voulait être trompé, s’y trompa.
Un décret appela au service la garde mobile de l’Empire, cette même garde mobile que le mauvais vouloir des soldats qui la composaient, ajouté à l’opposition aveugle et tenace de la gauche, semblaient condamner à un éternel repos. En un jour elle passa du sommeil des cartons à la vie agitée des camps. L’École centrale se hâta de fermer ses portes et d’expédier les diplômes à ceux des concurrents désignés par leur numéro d’ordre. Ingénieur civil depuis quelques heures, j’étais soldat et faisais partie du bataillon de Passy portant le no 13.
La garde mobile de la Seine n’était pas encore organisée, qu’il était facile déjà de reconnaître le mauvais esprit qui l’animait. Elle poussait l’amour de l’indiscipline jusqu’à l’absurde.
Qui ne se rappelle encore ces départs bruyants qui remplissaient la rue Lafayette de voitures de toute sorte conduisant à la gare du chemin de fer de l’Est des bataillons composés d’éléments de toute nature ? Quelles attitudes ! quel tapage ! quels cris ! À la vue de ces bandes qui partaient en fiacre après boire, il était aisé de pressentir quel triste exemple elles donneraient.
Mon bataillon partit le 6 août pour le camp de Châlons ; ce furent, jusqu’à la gare de la Villette, où il s’embarqua, les mêmes cris, les mêmes voitures, les mêmes chants. Des voix enrouées chantaient encore à Château-Thierry. Les chefs de gare ne savaient auquel entendre, les hommes d’équipe étaient dans l’ahurissement. À chaque halte nouvelle, c’était une débandade. Les moblots s’envolaient des voitures et couraient aux buvettes, quelques-uns s’y oubliaient. On faisait à ceux d’entre nous qui avaient conservé leur sang-froid des récits lamentables de ce qui s’était passé la veille et les jours précédents. Un certain nombre de ces enfants de Paris avaient exécuté de véritables razzias dans les buffets, où tout avait disparu, la vaisselle après les comestibles ; les plus facétieux emportaient les verres et les assiettes, qu’ils jetaient, chemin faisant, par la portière des wagons ; histoire de faire du bruit et de rire un peu. Des courses impétueuses lançaient les officiers zélés à la poursuite des soldats qui s’égaraient dans les fermes voisines, trouvant drôle « de cueillir çà et là » des lapins et des poules. On se mettait aux fenêtres pour les voir.
À mon arrivée à Châlons, la gare et les salles d’attente, les cours, les hangars, étaient remplis d’éclopés et de blessés couchés par terre, étendus sur des bancs, s’appuyant aux murs.
Là étaient les débris vivants des meurtrières rencontres des premiers jours : dragons, zouaves, chasseurs de Vincennes, turcos, soldats de la ligne, hussards, lanciers, tous hâves, silencieux, mornes, traînant ce qui leur restait de souffle. Point de paille, point d’ambulance, point de médecins. Ils attendaient qu’un convoi les prît. Des centaines de wagons encombraient la voie. Il fallait dix manœuvres pour le passage d’un train. Le personnel de la gare ne dormait plus, était sur les dents.
Au moment où nous allions quitter Paris, nous avions eu la nouvelle de ces défaites, sitôt suivies d’irréparables désastres. Maintenant j’avais sous les yeux le témoignage sanglant et mutilé de ces chocs terribles au-devant desquels on avait couru d’un cœur si léger. Mon ardeur n’en était pas diminuée ; mais la pitié me prenait à la gorge à la vue de ces malheureux, dont plusieurs attendaient encore un premier pansement. Quoi ! tant de misères et si peu de secours !
Le chemin de fer établi pour le service du camp emmena les mobiles au Petit-Mourmelon, d’où une première étape les conduisit à leur campement, le sac au dos. Pour un garçon qui, la veille encore, voyageait à Paris en voiture et n’avait fatigué ses pieds que sur l’asphalte du boulevard, la transition était brusque. Ce ne fut donc pas sans un certain sentiment de bonheur que j’aperçus la tente dans laquelle je devais prendre gîte, moi seizième. L’espace n’était pas immense, et quelques vents coulis, qui avaient, quoique au cœur de l’été, des fraîcheurs de novembre, passaient bien par les fentes de la toile et les interstices laissés au ras du sol ; mais il y avait de la paille, et, serrés les uns contre les autres, se servant mutuellement de calorifères, les mobiles, la fatigue aidant, dormirent comme des soldats.
Aux premières lueurs du jour, un coup de canon retentit : c’était le réveil. Comme des abeilles sortent des ruches, des milliers de mobiles s’échappaient des tentes, en s’étirant. L’un avait le bras endolori, l’autre la jambe engourdie. Le concert des plaintes commença. L’élément comique s’y mêlait à haute dose ; quelques-uns s’étonnèrent qu’on les eût réveillés si tôt, d’autres se plaignirent de n’avoir pas de café à la crème. Au nombre de ces conscrits de quelques jours si méticuleux sur la question du confortable, j’en avais remarqué un qui, la veille au soir, avait paru surpris de ne point trouver de souper dressé sous la tente.
— À quoi songe-t-on ? s’était-il écrié.
Au mois de juillet 1870, j’achevais la troisième année de mes études à l’École centrale des arts et manufactures. C’était le moment où la guerre, qui allait être déclarée, remplissait Paris de tumulte et de bruit. Dans nos théâtres, tout un peuple fouetté par les excitations d’une partie de la presse, écoutait debout, en le couvrant d’applaudissements frénétiques, le refrain terrible de cette Marseillaise qui devait nous mener à tant de désastres. Des régiments passaient sur les boulevards, accompagnés par les clameurs de milliers d’oisifs qui croyaient qu’on gagnait des batailles avec des cris. La ritournelle de la chanson des Girondins se promenait par les rues, psalmodiée par la voix des gavroches. Cette agitation factice pouvait faire supposer à un observateur inattentif que la grande ville désirait, appelait la guerre ; le gouvernement, qui voulait être trompé, s’y trompa.
Un décret appela au service la garde mobile de l’Empire, cette même garde mobile que le mauvais vouloir des soldats qui la composaient, ajouté à l’opposition aveugle et tenace de la gauche, semblaient condamner à un éternel repos. En un jour elle passa du sommeil des cartons à la vie agitée des camps. L’École centrale se hâta de fermer ses portes et d’expédier les diplômes à ceux des concurrents désignés par leur numéro d’ordre. Ingénieur civil depuis quelques heures, j’étais soldat et faisais partie du bataillon de Passy portant le no 13.
La garde mobile de la Seine n’était pas encore organisée, qu’il était facile déjà de reconnaître le mauvais esprit qui l’animait. Elle poussait l’amour de l’indiscipline jusqu’à l’absurde.
Qui ne se rappelle encore ces départs bruyants qui remplissaient la rue Lafayette de voitures de toute sorte conduisant à la gare du chemin de fer de l’Est des bataillons composés d’éléments de toute nature ? Quelles attitudes ! quel tapage ! quels cris ! À la vue de ces bandes qui partaient en fiacre après boire, il était aisé de pressentir quel triste exemple elles donneraient.
Mon bataillon partit le 6 août pour le camp de Châlons ; ce furent, jusqu’à la gare de la Villette, où il s’embarqua, les mêmes cris, les mêmes voitures, les mêmes chants. Des voix enrouées chantaient encore à Château-Thierry. Les chefs de gare ne savaient auquel entendre, les hommes d’équipe étaient dans l’ahurissement. À chaque halte nouvelle, c’était une débandade. Les moblots s’envolaient des voitures et couraient aux buvettes, quelques-uns s’y oubliaient. On faisait à ceux d’entre nous qui avaient conservé leur sang-froid des récits lamentables de ce qui s’était passé la veille et les jours précédents. Un certain nombre de ces enfants de Paris avaient exécuté de véritables razzias dans les buffets, où tout avait disparu, la vaisselle après les comestibles ; les plus facétieux emportaient les verres et les assiettes, qu’ils jetaient, chemin faisant, par la portière des wagons ; histoire de faire du bruit et de rire un peu. Des courses impétueuses lançaient les officiers zélés à la poursuite des soldats qui s’égaraient dans les fermes voisines, trouvant drôle « de cueillir çà et là » des lapins et des poules. On se mettait aux fenêtres pour les voir.
À mon arrivée à Châlons, la gare et les salles d’attente, les cours, les hangars, étaient remplis d’éclopés et de blessés couchés par terre, étendus sur des bancs, s’appuyant aux murs.
Là étaient les débris vivants des meurtrières rencontres des premiers jours : dragons, zouaves, chasseurs de Vincennes, turcos, soldats de la ligne, hussards, lanciers, tous hâves, silencieux, mornes, traînant ce qui leur restait de souffle. Point de paille, point d’ambulance, point de médecins. Ils attendaient qu’un convoi les prît. Des centaines de wagons encombraient la voie. Il fallait dix manœuvres pour le passage d’un train. Le personnel de la gare ne dormait plus, était sur les dents.
Au moment où nous allions quitter Paris, nous avions eu la nouvelle de ces défaites, sitôt suivies d’irréparables désastres. Maintenant j’avais sous les yeux le témoignage sanglant et mutilé de ces chocs terribles au-devant desquels on avait couru d’un cœur si léger. Mon ardeur n’en était pas diminuée ; mais la pitié me prenait à la gorge à la vue de ces malheureux, dont plusieurs attendaient encore un premier pansement. Quoi ! tant de misères et si peu de secours !
Le chemin de fer établi pour le service du camp emmena les mobiles au Petit-Mourmelon, d’où une première étape les conduisit à leur campement, le sac au dos. Pour un garçon qui, la veille encore, voyageait à Paris en voiture et n’avait fatigué ses pieds que sur l’asphalte du boulevard, la transition était brusque. Ce ne fut donc pas sans un certain sentiment de bonheur que j’aperçus la tente dans laquelle je devais prendre gîte, moi seizième. L’espace n’était pas immense, et quelques vents coulis, qui avaient, quoique au cœur de l’été, des fraîcheurs de novembre, passaient bien par les fentes de la toile et les interstices laissés au ras du sol ; mais il y avait de la paille, et, serrés les uns contre les autres, se servant mutuellement de calorifères, les mobiles, la fatigue aidant, dormirent comme des soldats.
Aux premières lueurs du jour, un coup de canon retentit : c’était le réveil. Comme des abeilles sortent des ruches, des milliers de mobiles s’échappaient des tentes, en s’étirant. L’un avait le bras endolori, l’autre la jambe engourdie. Le concert des plaintes commença. L’élément comique s’y mêlait à haute dose ; quelques-uns s’étonnèrent qu’on les eût réveillés si tôt, d’autres se plaignirent de n’avoir pas de café à la crème. Au nombre de ces conscrits de quelques jours si méticuleux sur la question du confortable, j’en avais remarqué un qui, la veille au soir, avait paru surpris de ne point trouver de souper dressé sous la tente.
— À quoi songe-t-on ? s’était-il écrié.