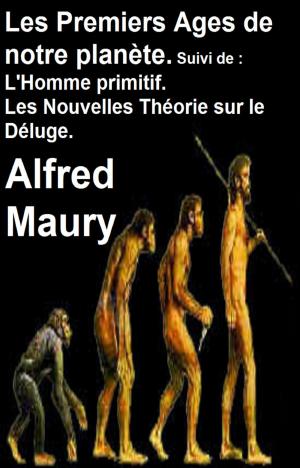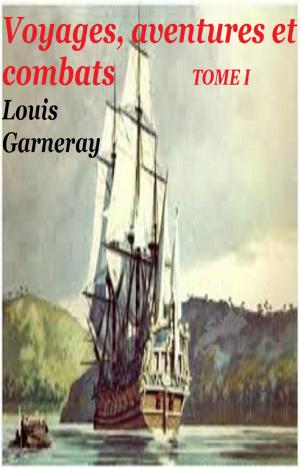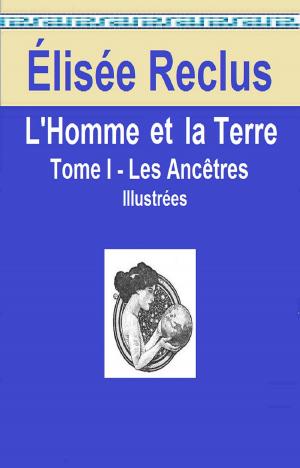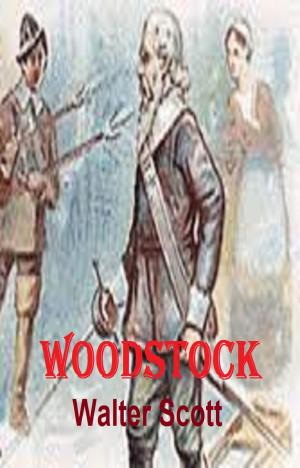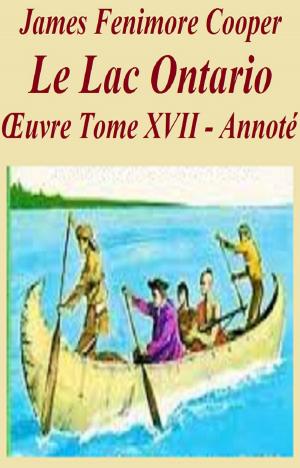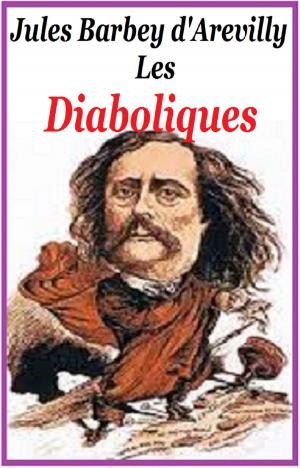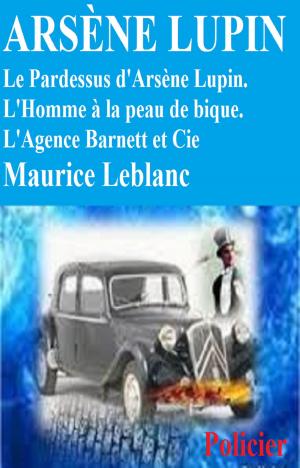| Author: | JEAN JAURÈS | ISBN: | 1230002767383 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | October 31, 2018 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | JEAN JAURÈS |
| ISBN: | 1230002767383 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | October 31, 2018 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Le 1er janvier 1814, la coalition européenne avait jeté près d’un million de soldats sur la France. Le flot sombre des uniformes lointains avait mis près de trois mois à recouvrir le pays, depuis la frontière de l’est jusqu’à Paris. Les ennemis ne s’approchaient qu’avec une terreur mêlée de respect de cette capitale jusqu’alors inviolée, et qui semblait devoir tenir toujours en réserve quelque prodige. Mais le 30 mars, pour la première fois depuis bien des siècles, Paris aperçut la fumée d’un camp ennemi. Enserré par plus de deux cent mille hommes, il subit la mitraille continuelle. À l’intérieur de la ville, vingt mille hommes, débris d’armées épuisées et refoulées, résistaient encore, mêlés de polytechniciens, aussi d’hommes du peuple. Les chefs, Mortier, Moncey, Marmont, coupés de l’empereur depuis des jours, déshabitués, par la formidable initiative du conquérant, de toute énergie propre, se battaient en soldats, ne commandaient pas en généraux. Sous les pas de l’ennemi, peu à peu ils reculaient, ayant sous leurs ordres, quelquefois contradictoires, exactement l’effectif suffisant pour couvrir un cinquième de l’énorme enceinte qu’il eût fallu défendre. De la ville morne aucun enthousiasme ne jaillissait ; aucune peur non plus n’apparaissait. Sauf en ses quartiers populaires les plus exposés, Paris semblait absent de lui-même. Pendant la fusillade, alors que les obus tombaient sur les quartiers qui constituent maintenant la Trinité, la population, sur les boulevards, échangeait à voix basse ses impressions.
Le matin du 30 mars, l’impératrice et le roi de Rome, sur la pression de Joseph et du conseil, en dépit de l’opposition calculée de Talleyrand, avaient quitté Paris. Leur carrosse, suivi d’innombrables voitures, avait amené hors de Paris, en Touraine, l’impératrice qui quittait sans une larme, sans un regret, un trône que la loi des diplomaties lui avait imposé. Le long convoi, le triste convoi de l’Empire, avait défilé sous le regard de quelques passants, et cette fuite d’une dynastie attestait l’inutilité de la défense. Joseph, il est vrai, restait, médiocre représentant de l’empereur, invisible et intolérable. Mais à qui n’avait pas su conserver Madrid et le trône d’Espagne, l’autorité manquait pour protéger Paris et le trône de Napoléon. Du reste, au mépris d’une promesse solennelle, lui aussi devait fuir… Cependant, il avait laissé à Marmont la latitude de capituler quand l’heure semblerait décisive.
Le duc de Raguse, dont la capacité militaire aurait répudié, si elle l’eût pu, la terrible tâche de défendre Paris, continuait le combat. Mais le cercle noir des uniformes enserrait de plus en plus la ville, l’étouffait, devenait son seul horizon. Rien que sous la pression physique de tant d’hommes, les combattants, peu à peu, reculaient. Les postes étaient intenables. Les barrières emportées et reprises, et emportées encore, ouvrirent au flot les rues de la ville. Maintenant on se battait de maison à maison, de porte à porte, et les fenêtres étaient des créneaux. Marmont, blessé, les habits en lambeaux, l’épée dans sa seule main valide, n’était plus que le chef dérisoire d’une armée fictive… Vers les quatre heures, il dépêcha vers l’ennemi des parlementaires. Si vive était la fusillade que le premier fut tué, les deux autres furent blessés. Labédoyère revint, ne pouvant se faire jour à travers la mitraille. Enfin, par la route où commandait le général Compan, et qui était plus protégée, un parlementaire se put montrer. Il parla, offrit une suspension d’armes. Le feu cessa vers les cinq heures du soir.
Était-ce là tout l’effort que pouvait tenter Paris ? N’avait-il pas des hommes et des munitions ? N’aurait-il pas dû être organisé en vue d’un siège que la plus élémentaire prudence devait prévoir ? Est-ce la trahison, est-ce l’inertie, est-ce l’anarchie, est-ce l’ignorance qui furent les complices de la défaite ? Napoléon, en tous cas, était le premier coupable. Coupable de n’avoir pas prévu, dès le mois de janvier 1814, que la coalition tendait vers Paris ; coupable de n’avoir pas armé la capitale ; coupable de n’avoir pas compris que la reddition de Paris, ce n’était pas seulement une défaite militaire, mais une catastrophe dynastique.
Il a prétendu, il est vrai, avoir laissé des ordres, et le témoignage du général Dejean, son aide de camp, par lui dépêché à Joseph en fuite et qu’il rejoignit au bois de Boulogne, demeure décisif. Mais un chef tel que lui, habitué à tout prévoir et qui avait fait si souvent entrer la faiblesse humaine dans ses calculs, ne se contente pas de donner des ordres : il laisse des subordonnés capables de les comprendre et de les exécuter. Or, sur qui reposait, en ces journées décisives, la confiance de Napoléon ? Sur son frère Joseph dont il avait mesuré la médiocrité en toutes matières et en toutes occasions ; sur le ministre de la guerre Clarke, duc de Feltre, qu’une carrière exclusivement menée dans les bureaux prédisposait peu à des responsabilités soudaines. Puis, près d’eux Hullin, en qui le général n’avait pas effacé le simple soldat, Savary, absorbé par le contrôle minutieux et policier que comportait sa charge. Et c’est tout. Fallait-il s’étonner si ces médiocrités réunies n’avaient pu faire face au péril ? Une seule explication peut être tentée : c’est que Napoléon espérait revenir à Paris. Mais cependant, s’il devait revenir, pourquoi avait-il donné des ordres inconciliables avec sa présence ? Et, quand il a vu qu’il ne pouvait se rejeter dans Paris, pourquoi n’avoir pas chargé d’une mission de fermeté et de résistance un maréchal ? Il y avait bien Mortier, il y avait bien Marmont. Mais ils étaient venus, sans le savoir, s’engouffrer dans Paris, les Prussiens derrière eux ; et si, au lieu de se jeter dans ses murs, ils eussent bifurqué vers le centre ou vers la Loire, Paris n’avait pas un seul homme de guerre pour préparer sa défense.
Le 1er janvier 1814, la coalition européenne avait jeté près d’un million de soldats sur la France. Le flot sombre des uniformes lointains avait mis près de trois mois à recouvrir le pays, depuis la frontière de l’est jusqu’à Paris. Les ennemis ne s’approchaient qu’avec une terreur mêlée de respect de cette capitale jusqu’alors inviolée, et qui semblait devoir tenir toujours en réserve quelque prodige. Mais le 30 mars, pour la première fois depuis bien des siècles, Paris aperçut la fumée d’un camp ennemi. Enserré par plus de deux cent mille hommes, il subit la mitraille continuelle. À l’intérieur de la ville, vingt mille hommes, débris d’armées épuisées et refoulées, résistaient encore, mêlés de polytechniciens, aussi d’hommes du peuple. Les chefs, Mortier, Moncey, Marmont, coupés de l’empereur depuis des jours, déshabitués, par la formidable initiative du conquérant, de toute énergie propre, se battaient en soldats, ne commandaient pas en généraux. Sous les pas de l’ennemi, peu à peu ils reculaient, ayant sous leurs ordres, quelquefois contradictoires, exactement l’effectif suffisant pour couvrir un cinquième de l’énorme enceinte qu’il eût fallu défendre. De la ville morne aucun enthousiasme ne jaillissait ; aucune peur non plus n’apparaissait. Sauf en ses quartiers populaires les plus exposés, Paris semblait absent de lui-même. Pendant la fusillade, alors que les obus tombaient sur les quartiers qui constituent maintenant la Trinité, la population, sur les boulevards, échangeait à voix basse ses impressions.
Le matin du 30 mars, l’impératrice et le roi de Rome, sur la pression de Joseph et du conseil, en dépit de l’opposition calculée de Talleyrand, avaient quitté Paris. Leur carrosse, suivi d’innombrables voitures, avait amené hors de Paris, en Touraine, l’impératrice qui quittait sans une larme, sans un regret, un trône que la loi des diplomaties lui avait imposé. Le long convoi, le triste convoi de l’Empire, avait défilé sous le regard de quelques passants, et cette fuite d’une dynastie attestait l’inutilité de la défense. Joseph, il est vrai, restait, médiocre représentant de l’empereur, invisible et intolérable. Mais à qui n’avait pas su conserver Madrid et le trône d’Espagne, l’autorité manquait pour protéger Paris et le trône de Napoléon. Du reste, au mépris d’une promesse solennelle, lui aussi devait fuir… Cependant, il avait laissé à Marmont la latitude de capituler quand l’heure semblerait décisive.
Le duc de Raguse, dont la capacité militaire aurait répudié, si elle l’eût pu, la terrible tâche de défendre Paris, continuait le combat. Mais le cercle noir des uniformes enserrait de plus en plus la ville, l’étouffait, devenait son seul horizon. Rien que sous la pression physique de tant d’hommes, les combattants, peu à peu, reculaient. Les postes étaient intenables. Les barrières emportées et reprises, et emportées encore, ouvrirent au flot les rues de la ville. Maintenant on se battait de maison à maison, de porte à porte, et les fenêtres étaient des créneaux. Marmont, blessé, les habits en lambeaux, l’épée dans sa seule main valide, n’était plus que le chef dérisoire d’une armée fictive… Vers les quatre heures, il dépêcha vers l’ennemi des parlementaires. Si vive était la fusillade que le premier fut tué, les deux autres furent blessés. Labédoyère revint, ne pouvant se faire jour à travers la mitraille. Enfin, par la route où commandait le général Compan, et qui était plus protégée, un parlementaire se put montrer. Il parla, offrit une suspension d’armes. Le feu cessa vers les cinq heures du soir.
Était-ce là tout l’effort que pouvait tenter Paris ? N’avait-il pas des hommes et des munitions ? N’aurait-il pas dû être organisé en vue d’un siège que la plus élémentaire prudence devait prévoir ? Est-ce la trahison, est-ce l’inertie, est-ce l’anarchie, est-ce l’ignorance qui furent les complices de la défaite ? Napoléon, en tous cas, était le premier coupable. Coupable de n’avoir pas prévu, dès le mois de janvier 1814, que la coalition tendait vers Paris ; coupable de n’avoir pas armé la capitale ; coupable de n’avoir pas compris que la reddition de Paris, ce n’était pas seulement une défaite militaire, mais une catastrophe dynastique.
Il a prétendu, il est vrai, avoir laissé des ordres, et le témoignage du général Dejean, son aide de camp, par lui dépêché à Joseph en fuite et qu’il rejoignit au bois de Boulogne, demeure décisif. Mais un chef tel que lui, habitué à tout prévoir et qui avait fait si souvent entrer la faiblesse humaine dans ses calculs, ne se contente pas de donner des ordres : il laisse des subordonnés capables de les comprendre et de les exécuter. Or, sur qui reposait, en ces journées décisives, la confiance de Napoléon ? Sur son frère Joseph dont il avait mesuré la médiocrité en toutes matières et en toutes occasions ; sur le ministre de la guerre Clarke, duc de Feltre, qu’une carrière exclusivement menée dans les bureaux prédisposait peu à des responsabilités soudaines. Puis, près d’eux Hullin, en qui le général n’avait pas effacé le simple soldat, Savary, absorbé par le contrôle minutieux et policier que comportait sa charge. Et c’est tout. Fallait-il s’étonner si ces médiocrités réunies n’avaient pu faire face au péril ? Une seule explication peut être tentée : c’est que Napoléon espérait revenir à Paris. Mais cependant, s’il devait revenir, pourquoi avait-il donné des ordres inconciliables avec sa présence ? Et, quand il a vu qu’il ne pouvait se rejeter dans Paris, pourquoi n’avoir pas chargé d’une mission de fermeté et de résistance un maréchal ? Il y avait bien Mortier, il y avait bien Marmont. Mais ils étaient venus, sans le savoir, s’engouffrer dans Paris, les Prussiens derrière eux ; et si, au lieu de se jeter dans ses murs, ils eussent bifurqué vers le centre ou vers la Loire, Paris n’avait pas un seul homme de guerre pour préparer sa défense.