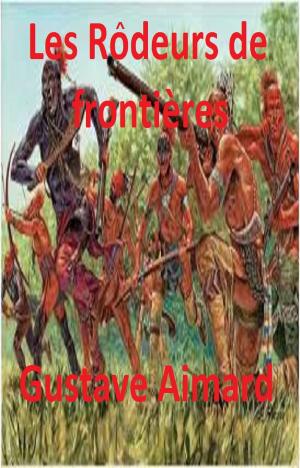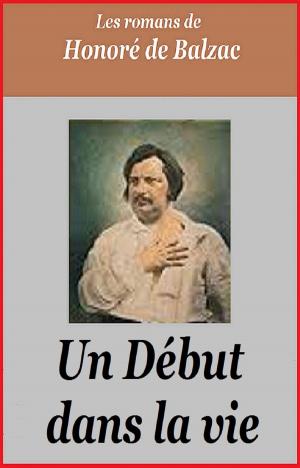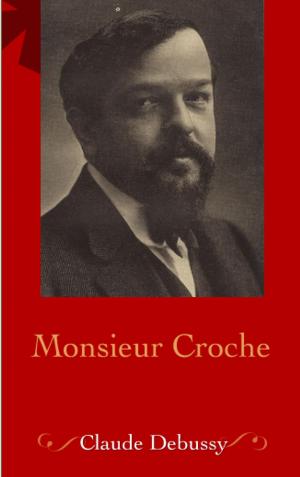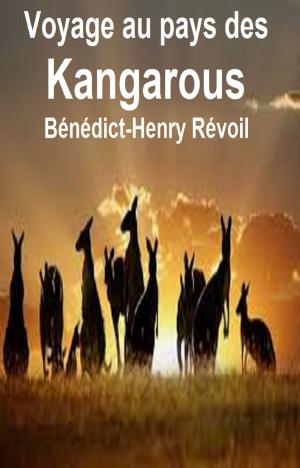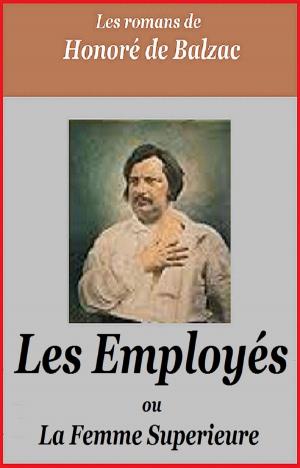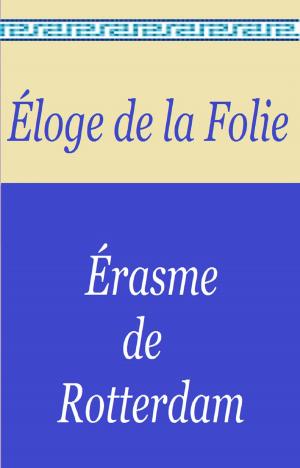| Author: | Voltaire | ISBN: | 1230003296561 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | June 26, 2019 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | Voltaire |
| ISBN: | 1230003296561 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | June 26, 2019 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
INTRODUCTION.
Ce n’est pas seulement la vie de Louis XIV qu’on prétend écrire ; on se propose un plus grand objet. On veut essayer de peindre à la postérité, non les actions d’un seul homme, mais l’esprit des hommes dans le siècle le plus éclairé qui fut jamais.
Tous les temps ont produit des héros et des politiques ; tous les peuples ont éprouvé des révolutions ; toutes les histoires sont presque égales pour qui ne veut mettre que des faits dans sa mémoire. Mais quiconque pense, et, ce qui est encore plus rare, quiconque a du goût, ne compte que quatre siècles dans l’histoire du monde. Ces quatre âges heureux sont ceux où les arts ont été perfectionnés, et qui, servant d’époque à la grandeur de l’esprit humain, sont l’exemple de la postérité.
Le premier de ces siècles, à qui la véritable gloire est attachée, est celui de Philippe et d’Alexandre, ou celui des Périclès, des Démosthène, des Aristote, des Platon, des Apelle, des Phidias, des Praxitèle ; et cet honneur a été renfermé dans les limites de la Grèce : le reste de la terre alors connue était barbare.
Le second âge est celui de César et d’Auguste, désigné encore par les noms de Lucrèce, de Cicéron, de Tite-Live, de Virgile, d’Horace, d’Ovide, de Varron, de Vitruve.
Le troisième est celui qui suivit la prise de Constantinople par Mahomet II. Le lecteur peut se souvenir qu’on vit alors en Italie une famille de simples citoyens faire ce que devaient entreprendre les rois de l’Europe. Les Médicis appelèrent à Florence les savants, que les Turcs chassaient de la Grèce : c’était le temps de la gloire de l’Italie. Les beaux-arts y avaient déjà repris une vie nouvelle ; les Italiens les honorèrent du nom de vertu, comme les premiers Grecs les avaient caractérisés du nom de sagesse. Tout tendait à la perfection.
Les arts, toujours transplantés de Grèce en Italie, se trouvaient dans un terrain favorable, où ils fructifiaient tout à coup. La France, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne, voulurent à leur tour avoir de ces fruits ; mais ou ils ne vinrent point dans ces climats, ou bien ils dégénérèrent trop vite.
François Ier encouragea des savants, mais qui ne furent que savants ; il eut des architectes, mais il n’eut ni des Michel-Ange, ni des Palladio ; il voulut en vain établir des écoles de peinture : les peintres italiens qu’il appela ne firent point d’élèves français. Quelques épigrammes et quelques contes libres composaient toute notre poésie. Rabelais était notre seul livre de prose à la mode, du temps de Henri II.
En un mot, les Italiens seuls avaient tout, si vous en exceptez la musique, qui n’était pas encore perfectionnée, et la philosophie expérimentale, inconnue partout également, et qu’enfin Galilée fit connaître.
Le quatrième siècle est celui qu’on nomme le siècle de Louis XIV, et c’est peut-être celui des quatre qui approche le plus de la perfection. Enrichi des découvertes des trois autres, il a plus fait en certains genres que les trois ensembles. Tous les arts, à la vérité, n’ont point été poussés plus loin que sous les Médicis, sous les Auguste et les Alexandre ; mais la raison humaine en général s’est perfectionnée. La saine philosophie n’a été connue que dans ce temps, et il est vrai de dire qu’à commencer depuis les dernières années du cardinal de Richelieu jusqu’à celles qui ont suivi la mort de Louis XIV il s’est fait, dans nos arts, dans nos esprits, dans nos mœurs, comme dans notre gouvernement, une révolution générale qui doit servir de marque éternelle à la véritable gloire de notre patrie. Cette heureuse influence ne s’est pas même arrêtée en France : elle s’est étendue en Angleterre ; elle a excité l’émulation dont avait alors besoin cette nation spirituelle et hardie ; elle a porté le goût en Allemagne, les sciences en Russie ; elle a même ranimé l’Italie, qui languissait, et l’Europe a dû sa politesse et l’esprit de société à la cour de Louis XIV.
Il ne faut pas croire que ces quatre siècles aient été exempts de malheurs et de crimes. La perfection des arts cultivés par des citoyens paisibles n’empêche pas les princes d’être ambitieux, les peuples d’être séditieux, les prêtres et les moines d’être quelquefois remuants et fourbes. Tous les siècles se ressemblent par la méchanceté des hommes ; mais je ne connais que ces quatre âges distingués par les grands talents.
Avant le siècle que j’appelle de Louis XIV, et qui commence à peu près à l’établissement de l’Académie française[1], les Italiens appelaient tous les ultramontains du nom de barbares ; il faut avouer que les Français méritaient en quelque sorte cette injure. Leurs pères joignaient la galanterie romanesque des Maures à la grossièreté gothique. Ils n’avaient presque aucun des arts aimables, ce qui prouve que les arts utiles étaient négligés : car lorsqu’on a perfectionné ce qui est nécessaire, on trouve bientôt le beau et l’agréable, et il n’est pas étonnant que la peinture, la sculpture, la poésie, l’éloquence, la philosophie, fussent presque inconnues à une nation qui, ayant des ports sur l’Océan et sur la Méditerranée, n’avait pourtant point de flotte, et qui, aimant le luxe à l’excès, avait à peine quelques manufactures grossières.
Les Juifs, les Génois, les Vénitiens, les Portugais, les Flamands, les Hollandais, les Anglais, firent tour à tour le commerce de la France, qui en ignorait les principes. Louis XIII, à son avènement à la couronne, n’avait pas un vaisseau ; Paris ne contenait pas quatre cent mille hommes, et n’était pas décoré de quatre beaux édifices ; les autres villes du royaume ressemblaient à ces bourgs qu’on voit au delà de la Loire. Toute la noblesse, cantonnée à la campagne dans des donjons entourés de fossés, opprimait ceux qui cultivent la terre. Les grands chemins étaient presque impraticables ; les villes étaient sans police, l’État sans argent, et le gouvernement presque toujours sans crédit parmi les nations étrangères.
INTRODUCTION.
Ce n’est pas seulement la vie de Louis XIV qu’on prétend écrire ; on se propose un plus grand objet. On veut essayer de peindre à la postérité, non les actions d’un seul homme, mais l’esprit des hommes dans le siècle le plus éclairé qui fut jamais.
Tous les temps ont produit des héros et des politiques ; tous les peuples ont éprouvé des révolutions ; toutes les histoires sont presque égales pour qui ne veut mettre que des faits dans sa mémoire. Mais quiconque pense, et, ce qui est encore plus rare, quiconque a du goût, ne compte que quatre siècles dans l’histoire du monde. Ces quatre âges heureux sont ceux où les arts ont été perfectionnés, et qui, servant d’époque à la grandeur de l’esprit humain, sont l’exemple de la postérité.
Le premier de ces siècles, à qui la véritable gloire est attachée, est celui de Philippe et d’Alexandre, ou celui des Périclès, des Démosthène, des Aristote, des Platon, des Apelle, des Phidias, des Praxitèle ; et cet honneur a été renfermé dans les limites de la Grèce : le reste de la terre alors connue était barbare.
Le second âge est celui de César et d’Auguste, désigné encore par les noms de Lucrèce, de Cicéron, de Tite-Live, de Virgile, d’Horace, d’Ovide, de Varron, de Vitruve.
Le troisième est celui qui suivit la prise de Constantinople par Mahomet II. Le lecteur peut se souvenir qu’on vit alors en Italie une famille de simples citoyens faire ce que devaient entreprendre les rois de l’Europe. Les Médicis appelèrent à Florence les savants, que les Turcs chassaient de la Grèce : c’était le temps de la gloire de l’Italie. Les beaux-arts y avaient déjà repris une vie nouvelle ; les Italiens les honorèrent du nom de vertu, comme les premiers Grecs les avaient caractérisés du nom de sagesse. Tout tendait à la perfection.
Les arts, toujours transplantés de Grèce en Italie, se trouvaient dans un terrain favorable, où ils fructifiaient tout à coup. La France, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne, voulurent à leur tour avoir de ces fruits ; mais ou ils ne vinrent point dans ces climats, ou bien ils dégénérèrent trop vite.
François Ier encouragea des savants, mais qui ne furent que savants ; il eut des architectes, mais il n’eut ni des Michel-Ange, ni des Palladio ; il voulut en vain établir des écoles de peinture : les peintres italiens qu’il appela ne firent point d’élèves français. Quelques épigrammes et quelques contes libres composaient toute notre poésie. Rabelais était notre seul livre de prose à la mode, du temps de Henri II.
En un mot, les Italiens seuls avaient tout, si vous en exceptez la musique, qui n’était pas encore perfectionnée, et la philosophie expérimentale, inconnue partout également, et qu’enfin Galilée fit connaître.
Le quatrième siècle est celui qu’on nomme le siècle de Louis XIV, et c’est peut-être celui des quatre qui approche le plus de la perfection. Enrichi des découvertes des trois autres, il a plus fait en certains genres que les trois ensembles. Tous les arts, à la vérité, n’ont point été poussés plus loin que sous les Médicis, sous les Auguste et les Alexandre ; mais la raison humaine en général s’est perfectionnée. La saine philosophie n’a été connue que dans ce temps, et il est vrai de dire qu’à commencer depuis les dernières années du cardinal de Richelieu jusqu’à celles qui ont suivi la mort de Louis XIV il s’est fait, dans nos arts, dans nos esprits, dans nos mœurs, comme dans notre gouvernement, une révolution générale qui doit servir de marque éternelle à la véritable gloire de notre patrie. Cette heureuse influence ne s’est pas même arrêtée en France : elle s’est étendue en Angleterre ; elle a excité l’émulation dont avait alors besoin cette nation spirituelle et hardie ; elle a porté le goût en Allemagne, les sciences en Russie ; elle a même ranimé l’Italie, qui languissait, et l’Europe a dû sa politesse et l’esprit de société à la cour de Louis XIV.
Il ne faut pas croire que ces quatre siècles aient été exempts de malheurs et de crimes. La perfection des arts cultivés par des citoyens paisibles n’empêche pas les princes d’être ambitieux, les peuples d’être séditieux, les prêtres et les moines d’être quelquefois remuants et fourbes. Tous les siècles se ressemblent par la méchanceté des hommes ; mais je ne connais que ces quatre âges distingués par les grands talents.
Avant le siècle que j’appelle de Louis XIV, et qui commence à peu près à l’établissement de l’Académie française[1], les Italiens appelaient tous les ultramontains du nom de barbares ; il faut avouer que les Français méritaient en quelque sorte cette injure. Leurs pères joignaient la galanterie romanesque des Maures à la grossièreté gothique. Ils n’avaient presque aucun des arts aimables, ce qui prouve que les arts utiles étaient négligés : car lorsqu’on a perfectionné ce qui est nécessaire, on trouve bientôt le beau et l’agréable, et il n’est pas étonnant que la peinture, la sculpture, la poésie, l’éloquence, la philosophie, fussent presque inconnues à une nation qui, ayant des ports sur l’Océan et sur la Méditerranée, n’avait pourtant point de flotte, et qui, aimant le luxe à l’excès, avait à peine quelques manufactures grossières.
Les Juifs, les Génois, les Vénitiens, les Portugais, les Flamands, les Hollandais, les Anglais, firent tour à tour le commerce de la France, qui en ignorait les principes. Louis XIII, à son avènement à la couronne, n’avait pas un vaisseau ; Paris ne contenait pas quatre cent mille hommes, et n’était pas décoré de quatre beaux édifices ; les autres villes du royaume ressemblaient à ces bourgs qu’on voit au delà de la Loire. Toute la noblesse, cantonnée à la campagne dans des donjons entourés de fossés, opprimait ceux qui cultivent la terre. Les grands chemins étaient presque impraticables ; les villes étaient sans police, l’État sans argent, et le gouvernement presque toujours sans crédit parmi les nations étrangères.