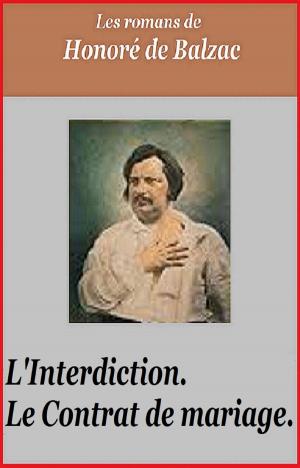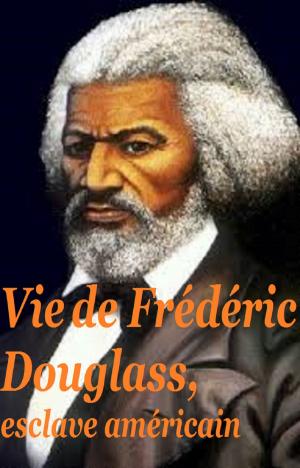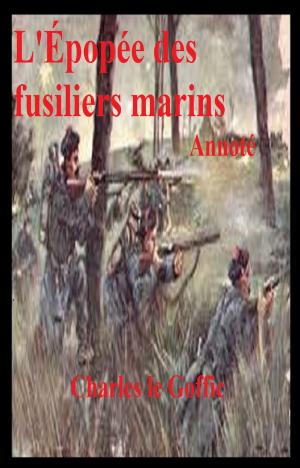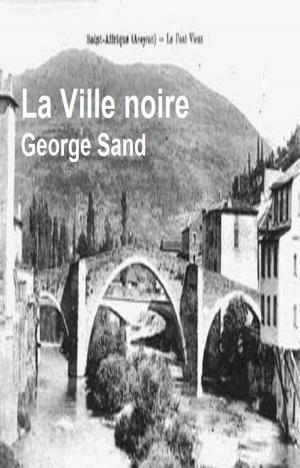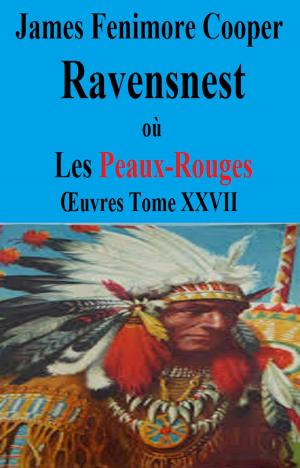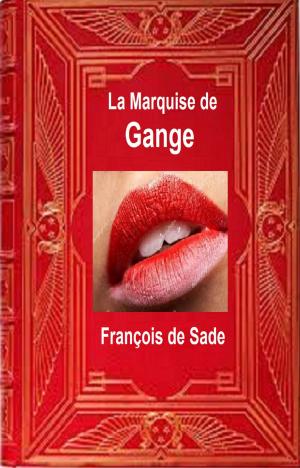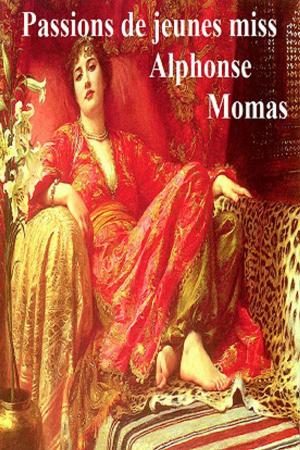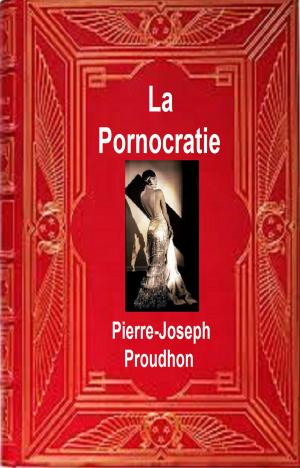| Author: | CLAIRE DE DURAS | ISBN: | 1230000212889 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | January 25, 2014 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | CLAIRE DE DURAS |
| ISBN: | 1230000212889 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | January 25, 2014 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
J’allais rejoindre à Baltimore mon régiment, qui faisait partie des troupes françaises employées dans la guerre d’Amérique ; et, pour éviter les lenteurs d’un convoi, je m’étais embarqué à Lorient sur un bâtiment marchand armé en guerre. Ce bâtiment portait avec moi trois passagers : l’un d’eux m’intéressa dès le premier moment que je l’aperçus ; c’était un grand jeune homme, d’une belle figure, dont les manières étaient simples et la physionomie spirituelle ; sa pâleur, et la tristesse dont toutes ses paroles et toutes ses actions étaient comme empreintes, éveillaient à la fois l’intérêt et la curiosité. Il était loin de les satisfaire ; il était habituellement silencieux, mais sans dédain.
On aurait dit, au contraire, qu’en lui la bienveillance avait survécu à d’autres qualités éteintes par le chagrin. Habituellement distrait, il n’attendait ni retour ni profit pour lui-même de rien de ce qu’il faisait. Cette facilité à vivre, qui vient du malheur, a quelque chose de touchant ; elle inspire plus de pitié que les plaintes les plus éloquentes. Je cherchais à me rapprocher de ce jeune homme ; mais, malgré l’espèce d’intimité forcée qu’amène la vie d’un vaisseau, je n’avançais pas. Lorsque j’allais m’asseoir auprès de lui, et que je lui adressais la parole, il répondait à mes questions ; et si elles ne touchaient à aucun des sentiments intimes du cœur, mais aux rapports vagues de la société, il ajoutait quelquefois une réflexion, mais dès que je voulais entrer dans le sujet des passions, ou des souffrances de l’âme, ce qui m’arrivait souvent, dans l’intention d’amener quelque confiance de sa part, il se levait, il s’éloignait, ou sa physionomie devenait si sombre que je ne me sentais pas le courage de continuer. Ce qu’il me montrait de lui aurait suffi de la part de tout autre, car il avait un esprit singulièrement original ; il ne voyait rien d’une manière commune, et cela venait de ce que la vanité n’était jamais mêlée à aucun de ses jugements. Il était l’homme le plus indépendant que j’aie connu ; le malheur l’avait rendu comme étranger aux autres hommes ; il était juste parce qu’il était impartial, et impartial parce que tout lui était indifférent. Lorsqu’une telle manière de voir ne rend pas fort égoïste, elle développe le jugement, et accroît les facultés de l’intelligence. On voyait que son esprit avait été fort cultivé ; mais, pendant toute la traversée, je ne le vis jamais ouvrir un livre ; rien en apparence ne remplissait pour lui la longue oisiveté de nos jours. Assis sur un banc à l’arrière du vaisseau, il restait des heures entières appuyé sur le bordage à regarder fixement la longue trace que le navire faisait sur les flots. Un jour il me dit : Quel fidèle emblème de la vie ! ainsi nous creusons péniblement notre sillon dans cet océan de misère qui se referme après nous. — À votre âge, lui dis-je, comment voyez-vous le monde sous un jour si triste ? — On est vieux, dit-il, quand on n’a plus d’espérance. — Ne peut-elle donc renaître ? lui demandai-je. — Jamais, répondit-il. Puis, me regardant tristement : Vous avez pitié de moi, me dit-il, je le vois ; croyez que j’en suis touché, mais je ne puis vous ouvrir mon cœur, ne le désirez même pas, il n’y a point de remède à mes maux, et tout m’est inutile désormais, même un ami. — Il me quitta en prononçant ces dernières paroles. J’essayai peu de jours après de reprendre la même conversation ; je lui parlai d’une aventure de ma jeunesse ; je lui racontai comment les conseils d’un ami m’avaient épargné une grande faute. Je voudrais, lui dis-je, être aujourd’hui pour vous ce qu’on fut alors pour moi. Il prit ma main : — Vous êtes trop bon, me dit-il ; mais vous ne savez pas ce que vous me demandez, vous voulez me faire du bien, et vous me feriez du mal : les grandes douleurs n’ont pas besoin de confidents ; l’âme qui peut les contenir se suffit à elle-même ; il faut entrevoir ailleurs l’espérance pour sentir le besoin de l’intérêt des autres ; à quoi bon toucher à des plaies inguérissables ? tout est fini pour moi dans la vie, et je suis déjà à mes yeux comme si je n’étais plus. — Il se leva, se mit à marcher sur le pont, et bientôt alla s’asseoir à l’autre extrémité du navire. Je quittai alors le banc que j’occupais pour lui donner la facilité d’y revenir ; c’était sa place favorite, et souvent même il y passait les nuits. Nous étions alors dans le parallèle des vents alisés, à l’ouest des Açores, et dans un climat délicieux.
J’allais rejoindre à Baltimore mon régiment, qui faisait partie des troupes françaises employées dans la guerre d’Amérique ; et, pour éviter les lenteurs d’un convoi, je m’étais embarqué à Lorient sur un bâtiment marchand armé en guerre. Ce bâtiment portait avec moi trois passagers : l’un d’eux m’intéressa dès le premier moment que je l’aperçus ; c’était un grand jeune homme, d’une belle figure, dont les manières étaient simples et la physionomie spirituelle ; sa pâleur, et la tristesse dont toutes ses paroles et toutes ses actions étaient comme empreintes, éveillaient à la fois l’intérêt et la curiosité. Il était loin de les satisfaire ; il était habituellement silencieux, mais sans dédain.
On aurait dit, au contraire, qu’en lui la bienveillance avait survécu à d’autres qualités éteintes par le chagrin. Habituellement distrait, il n’attendait ni retour ni profit pour lui-même de rien de ce qu’il faisait. Cette facilité à vivre, qui vient du malheur, a quelque chose de touchant ; elle inspire plus de pitié que les plaintes les plus éloquentes. Je cherchais à me rapprocher de ce jeune homme ; mais, malgré l’espèce d’intimité forcée qu’amène la vie d’un vaisseau, je n’avançais pas. Lorsque j’allais m’asseoir auprès de lui, et que je lui adressais la parole, il répondait à mes questions ; et si elles ne touchaient à aucun des sentiments intimes du cœur, mais aux rapports vagues de la société, il ajoutait quelquefois une réflexion, mais dès que je voulais entrer dans le sujet des passions, ou des souffrances de l’âme, ce qui m’arrivait souvent, dans l’intention d’amener quelque confiance de sa part, il se levait, il s’éloignait, ou sa physionomie devenait si sombre que je ne me sentais pas le courage de continuer. Ce qu’il me montrait de lui aurait suffi de la part de tout autre, car il avait un esprit singulièrement original ; il ne voyait rien d’une manière commune, et cela venait de ce que la vanité n’était jamais mêlée à aucun de ses jugements. Il était l’homme le plus indépendant que j’aie connu ; le malheur l’avait rendu comme étranger aux autres hommes ; il était juste parce qu’il était impartial, et impartial parce que tout lui était indifférent. Lorsqu’une telle manière de voir ne rend pas fort égoïste, elle développe le jugement, et accroît les facultés de l’intelligence. On voyait que son esprit avait été fort cultivé ; mais, pendant toute la traversée, je ne le vis jamais ouvrir un livre ; rien en apparence ne remplissait pour lui la longue oisiveté de nos jours. Assis sur un banc à l’arrière du vaisseau, il restait des heures entières appuyé sur le bordage à regarder fixement la longue trace que le navire faisait sur les flots. Un jour il me dit : Quel fidèle emblème de la vie ! ainsi nous creusons péniblement notre sillon dans cet océan de misère qui se referme après nous. — À votre âge, lui dis-je, comment voyez-vous le monde sous un jour si triste ? — On est vieux, dit-il, quand on n’a plus d’espérance. — Ne peut-elle donc renaître ? lui demandai-je. — Jamais, répondit-il. Puis, me regardant tristement : Vous avez pitié de moi, me dit-il, je le vois ; croyez que j’en suis touché, mais je ne puis vous ouvrir mon cœur, ne le désirez même pas, il n’y a point de remède à mes maux, et tout m’est inutile désormais, même un ami. — Il me quitta en prononçant ces dernières paroles. J’essayai peu de jours après de reprendre la même conversation ; je lui parlai d’une aventure de ma jeunesse ; je lui racontai comment les conseils d’un ami m’avaient épargné une grande faute. Je voudrais, lui dis-je, être aujourd’hui pour vous ce qu’on fut alors pour moi. Il prit ma main : — Vous êtes trop bon, me dit-il ; mais vous ne savez pas ce que vous me demandez, vous voulez me faire du bien, et vous me feriez du mal : les grandes douleurs n’ont pas besoin de confidents ; l’âme qui peut les contenir se suffit à elle-même ; il faut entrevoir ailleurs l’espérance pour sentir le besoin de l’intérêt des autres ; à quoi bon toucher à des plaies inguérissables ? tout est fini pour moi dans la vie, et je suis déjà à mes yeux comme si je n’étais plus. — Il se leva, se mit à marcher sur le pont, et bientôt alla s’asseoir à l’autre extrémité du navire. Je quittai alors le banc que j’occupais pour lui donner la facilité d’y revenir ; c’était sa place favorite, et souvent même il y passait les nuits. Nous étions alors dans le parallèle des vents alisés, à l’ouest des Açores, et dans un climat délicieux.