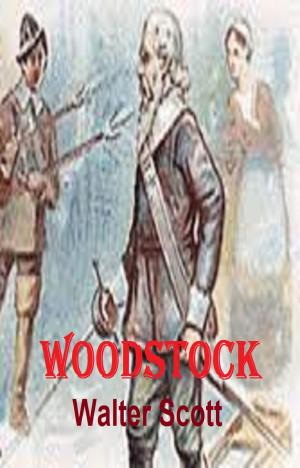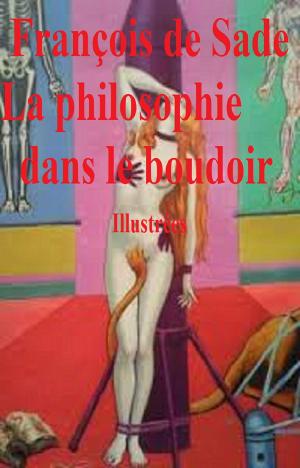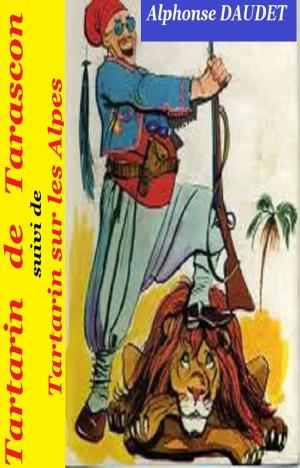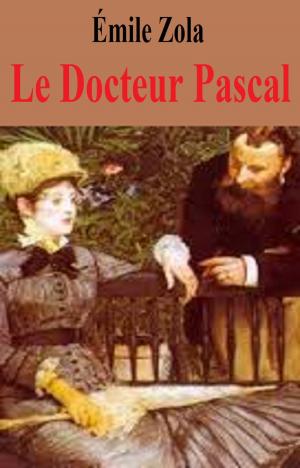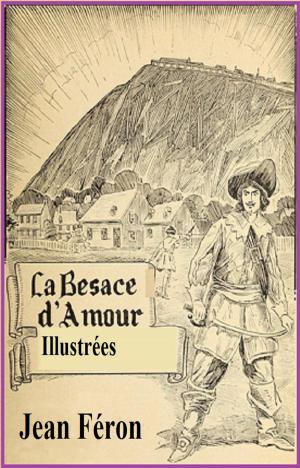| Author: | Vicente Blasco Ibáñez | ISBN: | 1230002797298 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | November 5, 2018 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | Vicente Blasco Ibáñez |
| ISBN: | 1230002797298 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | November 5, 2018 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Les jours qui suivirent, Jules et Argensola vécurent d’une vie enfiévrée par la rapidité avec laquelle se succédaient les événements. Chaque heure apportait une nouvelle, et ces nouvelles, presque toujours fausses, remuaient rudement l’opinion en sens contraires. Tantôt le péril de la guerre semblait conjuré ; tantôt le bruit courait que la mobilisation serait ordonnée dans quelques minutes. Un seul jour représentait les inquiétudes, les anxiétés, l’usure nerveuse d’une année ordinaire.
On apprit coup sur coup que l’Autriche déclarait la guerre à la Serbie ; que la Russie mobilisait une partie de son armée ; que l’Allemagne décrétait « l’état de menace de guerre » ; que les Austro-Hongrois, sans tenir compte des négociations en cours, commençaient le bombardement de Belgrade ; que Guillaume II, pour forcer le cours des événements et pour empêcher les négociations d’aboutir, faisait à son tour à la Russie une déclaration de guerre.
La France assistait à cette avalanche d’événements graves avec un recueillement sobre de paroles et de manifestations. Une résolution froide et solennelle animait tous les cœurs. Personne ne désirait la guerre, mais tout le monde l’acceptait avec le ferme propos d’accomplir son devoir. Pendant la journée, Paris se taisait, absorbé dans ses préoccupations. Seules quelques bandes de patriotes exaltés traversaient la place de la Concorde en acclamant la statue de Strasbourg. Dans les rues, les gens s’abordaient d’un air amical : il semblait qu’ils se connussent sans s’être jamais vus. Les yeux attiraient les yeux, les sourires se répondaient avec la sympathie d’une pensée commune. Les femmes étaient tristes ; mais, pour dissimuler leur émotion, elles parlaient plus fort. Le soir, dans le long crépuscule d’été, les boulevards s’emplissaient de monde ; les habitants des quartiers lointains affluaient vers le centre, comme aux jours des révolutions d’autrefois, et les groupes se réunissaient, formaient une foule immense d’où s’élevaient des cris et des chants. Ces multitudes se portaient jusqu’au cœur de Paris, où les lampes électriques venaient de s’allumer, et le défilé se prolongeait jusqu’à une heure avancée, avec le drapeau national flottant au-dessus des têtes parmi d’autres drapeaux qui lui faisaient escorte.
Dans une de ces nuits de sincère exaltation, les deux amis apprirent une nouvelle inattendue, incompréhensible, absurde : on venait d’assassiner Jaurès. Cette nouvelle, on la répétait dans les groupes avec un étonnement qui était plus grand encore que la douleur. « On a assassiné Jaurès ? Et pourquoi ? » Le bon sens populaire qui, par instinct, cherche une explication à tous les attentats, demeurait perplexe. Les hommes d’ordre redoutaient une révolution. Jules Desnoyers craignit un moment que les sinistres prédictions de son cousin Otto ne fussent sur le point de s’accomplir ; cet assassinat allait provoquer des représailles et aboutirait à une guerre civile. Mais les masses populaires, quoique cruellement affligées de la mort de leur héros favori, gardaient un tragique silence. Il n’était personne qui, par-delà ce cadavre, n’aperçût l’image auguste de la patrie.
Le matin suivant, le danger s’était évanoui. Les ouvriers parlaient de généraux et de guerre, se montraient les uns aux autres leurs livrets de soldats, annonçaient la date à laquelle ils partiraient, lorsque l’ordre de mobilisation aurait été publié.
Les événements continuaient à se succéder avec une rapidité qui n’était que trop significative. Les Allemands envahissaient le Luxembourg et s’avançaient jusque sur la frontière française, alors que leur ambassadeur était encore à Paris et y faisait des promesses de paix.
Le 1er août, dans l’après-midi, furent apposées précipitamment, çà et là, quelques petites affiches manuscrites auxquelles succédèrent bientôt de grandes affiches imprimées qui portaient en tête deux drapeaux croisés. C’était l’ordre de la mobilisation générale. La France entière allait courir aux armes.
— Cette fois, c’est fait ! dirent les gens arrêtés devant ces affiches.
Et les poitrines se dilatèrent, poussèrent un soupir de soulagement. Le cauchemar était fini ; la réalité cruelle était préférable à l’incertitude, à l’attente, à l’appréhension d’un obscur péril qui rendait les jours longs comme des semaines.
La mobilisation commençait à minuit. Dès le crépuscule, il se produisit dans tout Paris un mouvement extraordinaire. On aurait dit que les tramways, les automobiles et les voitures marchaient à une allure folle. Jamais on n’avait vu tant de fiacres, et pourtant les bourgeois qui auraient voulu en prendre un, faisaient de vains appels aux cochers : aucun cocher ne voulait travailler pour les civils. Tous les moyens de transport étaient pour les militaires, toutes les courses aboutissaient aux gares. Les lourds camions de l’intendance, pleins de sacs, étaient salués au passage par l’enthousiasme général, et les soldats habillés en mécaniciens qui manœuvraient ces pyramides roulantes, répondaient aux acclamations en agitant les bras et en poussant des cris joyeux. La foule se pressait, se bousculait, mais n’en gardait pas moins une insolite courtoisie. Lorsque deux véhicules s’accrochaient et que, par la force de l’habitude, les conducteurs allaient échanger des injures, le public s’interposait et les obligeait à se serrer la main. Les passants qui avaient failli être écrasés par une automobile riaient en criant au chauffeur : « Tuer un Français qui regagne son régiment ! » Et le chauffeur répondait : « Moi aussi, je pars demain. C’est ma dernière course. »
Les jours qui suivirent, Jules et Argensola vécurent d’une vie enfiévrée par la rapidité avec laquelle se succédaient les événements. Chaque heure apportait une nouvelle, et ces nouvelles, presque toujours fausses, remuaient rudement l’opinion en sens contraires. Tantôt le péril de la guerre semblait conjuré ; tantôt le bruit courait que la mobilisation serait ordonnée dans quelques minutes. Un seul jour représentait les inquiétudes, les anxiétés, l’usure nerveuse d’une année ordinaire.
On apprit coup sur coup que l’Autriche déclarait la guerre à la Serbie ; que la Russie mobilisait une partie de son armée ; que l’Allemagne décrétait « l’état de menace de guerre » ; que les Austro-Hongrois, sans tenir compte des négociations en cours, commençaient le bombardement de Belgrade ; que Guillaume II, pour forcer le cours des événements et pour empêcher les négociations d’aboutir, faisait à son tour à la Russie une déclaration de guerre.
La France assistait à cette avalanche d’événements graves avec un recueillement sobre de paroles et de manifestations. Une résolution froide et solennelle animait tous les cœurs. Personne ne désirait la guerre, mais tout le monde l’acceptait avec le ferme propos d’accomplir son devoir. Pendant la journée, Paris se taisait, absorbé dans ses préoccupations. Seules quelques bandes de patriotes exaltés traversaient la place de la Concorde en acclamant la statue de Strasbourg. Dans les rues, les gens s’abordaient d’un air amical : il semblait qu’ils se connussent sans s’être jamais vus. Les yeux attiraient les yeux, les sourires se répondaient avec la sympathie d’une pensée commune. Les femmes étaient tristes ; mais, pour dissimuler leur émotion, elles parlaient plus fort. Le soir, dans le long crépuscule d’été, les boulevards s’emplissaient de monde ; les habitants des quartiers lointains affluaient vers le centre, comme aux jours des révolutions d’autrefois, et les groupes se réunissaient, formaient une foule immense d’où s’élevaient des cris et des chants. Ces multitudes se portaient jusqu’au cœur de Paris, où les lampes électriques venaient de s’allumer, et le défilé se prolongeait jusqu’à une heure avancée, avec le drapeau national flottant au-dessus des têtes parmi d’autres drapeaux qui lui faisaient escorte.
Dans une de ces nuits de sincère exaltation, les deux amis apprirent une nouvelle inattendue, incompréhensible, absurde : on venait d’assassiner Jaurès. Cette nouvelle, on la répétait dans les groupes avec un étonnement qui était plus grand encore que la douleur. « On a assassiné Jaurès ? Et pourquoi ? » Le bon sens populaire qui, par instinct, cherche une explication à tous les attentats, demeurait perplexe. Les hommes d’ordre redoutaient une révolution. Jules Desnoyers craignit un moment que les sinistres prédictions de son cousin Otto ne fussent sur le point de s’accomplir ; cet assassinat allait provoquer des représailles et aboutirait à une guerre civile. Mais les masses populaires, quoique cruellement affligées de la mort de leur héros favori, gardaient un tragique silence. Il n’était personne qui, par-delà ce cadavre, n’aperçût l’image auguste de la patrie.
Le matin suivant, le danger s’était évanoui. Les ouvriers parlaient de généraux et de guerre, se montraient les uns aux autres leurs livrets de soldats, annonçaient la date à laquelle ils partiraient, lorsque l’ordre de mobilisation aurait été publié.
Les événements continuaient à se succéder avec une rapidité qui n’était que trop significative. Les Allemands envahissaient le Luxembourg et s’avançaient jusque sur la frontière française, alors que leur ambassadeur était encore à Paris et y faisait des promesses de paix.
Le 1er août, dans l’après-midi, furent apposées précipitamment, çà et là, quelques petites affiches manuscrites auxquelles succédèrent bientôt de grandes affiches imprimées qui portaient en tête deux drapeaux croisés. C’était l’ordre de la mobilisation générale. La France entière allait courir aux armes.
— Cette fois, c’est fait ! dirent les gens arrêtés devant ces affiches.
Et les poitrines se dilatèrent, poussèrent un soupir de soulagement. Le cauchemar était fini ; la réalité cruelle était préférable à l’incertitude, à l’attente, à l’appréhension d’un obscur péril qui rendait les jours longs comme des semaines.
La mobilisation commençait à minuit. Dès le crépuscule, il se produisit dans tout Paris un mouvement extraordinaire. On aurait dit que les tramways, les automobiles et les voitures marchaient à une allure folle. Jamais on n’avait vu tant de fiacres, et pourtant les bourgeois qui auraient voulu en prendre un, faisaient de vains appels aux cochers : aucun cocher ne voulait travailler pour les civils. Tous les moyens de transport étaient pour les militaires, toutes les courses aboutissaient aux gares. Les lourds camions de l’intendance, pleins de sacs, étaient salués au passage par l’enthousiasme général, et les soldats habillés en mécaniciens qui manœuvraient ces pyramides roulantes, répondaient aux acclamations en agitant les bras et en poussant des cris joyeux. La foule se pressait, se bousculait, mais n’en gardait pas moins une insolite courtoisie. Lorsque deux véhicules s’accrochaient et que, par la force de l’habitude, les conducteurs allaient échanger des injures, le public s’interposait et les obligeait à se serrer la main. Les passants qui avaient failli être écrasés par une automobile riaient en criant au chauffeur : « Tuer un Français qui regagne son régiment ! » Et le chauffeur répondait : « Moi aussi, je pars demain. C’est ma dernière course. »