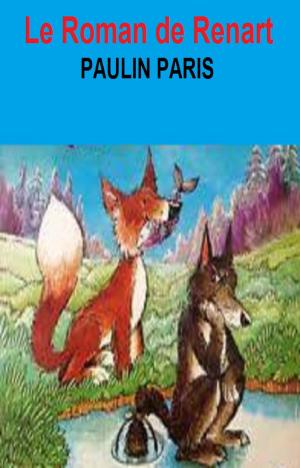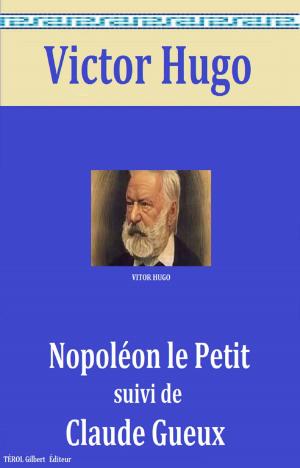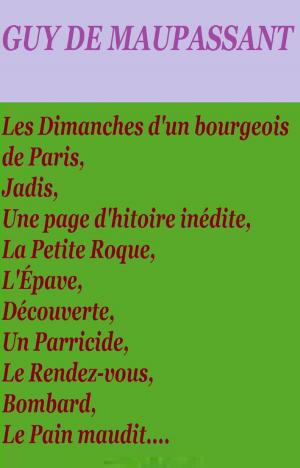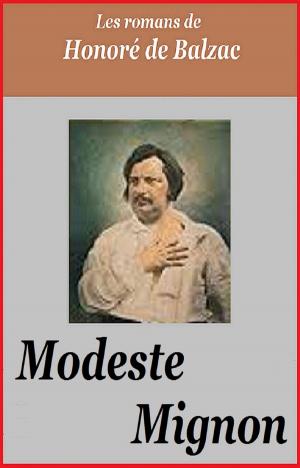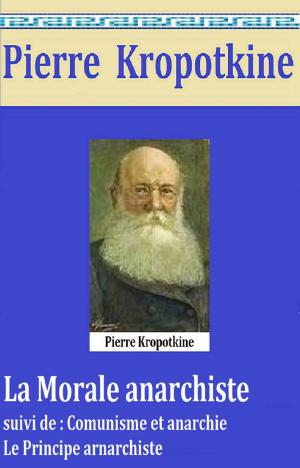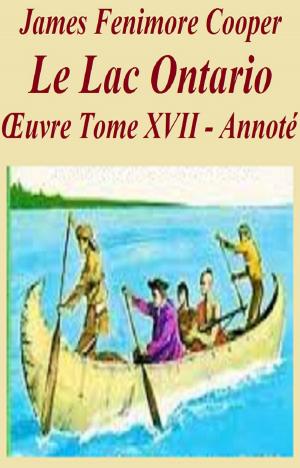| Author: | GEORGE SAND | ISBN: | 1230002753522 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | October 28, 2018 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | GEORGE SAND |
| ISBN: | 1230002753522 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | October 28, 2018 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Quand, pour la première fois, en 1846, je fus envoyé à la Faille-sur-Gouvre, la ville était malpropre, comme la plupart des villes de France, laide en ce sens qu’à l’exemple général du temps, on s’était acharné à l’embellir sans goût, et à détruire sans discernement ses vieux édifices ; mais elle était bien située au bord d’un plantureux ravin, et le faubourg offrait encore des rues tortueuses, grimpantes, d’un effet original, et des groupes d’anciennes constructions assez pittoresques.
Quand le destin m’y amena, je mis pied à terre avant d’arriver, et, m’étant enquis du nom de l’hôtel où le conducteur de la diligence déposerait mon bagage, j’entrai seul et pédestrement dans la ville.
J’avais une lettre de recommandation, une seule, et pour cause. Je ne m’occupai pas de mon gîte ; je demandai la place de la Comédie (vieux style), on dit aujourd’hui la place de la Maison-de-Ville, bien que le théâtre, la mairie et le tribunal vivent encore en bonne intelligence sous le même toit.
— C’est toujours tout droit, répondit-on.
Et, en effet, je me trouvai, au bout d’une longue rue, sur la place en question. Elle n’était pas grande : la maison de ville au fond, une maison bourgeoise à droite, un café à gauche. C’est à ce café que j’avais affaire.
Un grand et gros homme blond, jeune, d’une belle figure, agréable et douce, allait et venait d’une table à l’autre, tutoyant la plupart des consommateurs de son âge, tutoyé par ceux qui paraissaient avoir atteint la cinquantaine. Je demandai à la servante, qui m’indiquait une table vacante, où était le propriétaire de l’établissement, M. Narcisse Pardoux. J’avais à dessein prononcé son nom en le regardant. Il m’entendit malgré le grand bruit qui se faisait dans le billard, dont les portes ouvertes envoyaient jusqu’à nous d’épais nuages de fumée de pipe, et, sans paraître se distraire de ses nombreux consommateurs, il vint à moi et me dit en se penchant :
— Êtes-vous M. E…, de la part de M. T… ?
À quoi je répondis à voix basse :
— Je suis M. E… et je vous apporte une lettre de M. T…
— C’est bien, reprit-il.
Et, appelant Jeannette :
— Conduisez monsieur au jardin, lui dit-il tout bas.
Je suivis Jeannette, qui me fit traverser une petite rue derrière la maison. Elle poussa une porte et se retira en disant :
— M. Narcisse va venir.
J’étais entré dans un jardin bien fleuri et bien tenu. Il y avait, à gauche, une sorte de boulingrin planté d’arbustes, et surmonté d’un kiosque qui semblait approprié au même usage que le café d’où je sortais.
M. Pardoux vint me rejoindre presque aussitôt et me fit monter dans ce kiosque, sorte de tente couverte en zinc, où Jeannette nous apporta de la bière, des cigares et quelques liqueurs à choisir.
Je dirai très-succinctement le but de mon voyage dans cette ville, où je ne connaissais pas une âme. J’étais chargé, par le directeur d’une association de capitalistes sérieux, de faire des études sur la localité, en vue de l’établissement d’une exploitation industrielle d’une assez grande importance. M. Pardoux avait eu et suggéré cette idée, qui avait été traitée de rêve par les indigènes. Il s’était adressé à l’homme de progrès et d’intelligence dont je lui remettais la lettre. On m’envoyait vers lui pour qu’il me mît à même d’examiner son projet et d’en vérifier les chances de succès.
Il me les exposa avec beaucoup de logique et de clarté. Je reconnus vite en lui l’homme sans culture, mais doué du génie du bon sens, qui avait écrit plusieurs lettres remarquables à M. T…, mon directeur et mon ami, et, comme je me montrai disposé à le croire et à commencer mes études avec confiance, le bon Pardoux se livra à une joie enthousiaste.
— Enfin ! s’écria-t-il, voilà cinq ans que je m’époumone à dire à tous les gros bonnets de pays qu’il y a pour eux et pour les pauvres, une fortune dans mon idée. Et ils ne font que lever les épaules en répondant toujours :
Quand, pour la première fois, en 1846, je fus envoyé à la Faille-sur-Gouvre, la ville était malpropre, comme la plupart des villes de France, laide en ce sens qu’à l’exemple général du temps, on s’était acharné à l’embellir sans goût, et à détruire sans discernement ses vieux édifices ; mais elle était bien située au bord d’un plantureux ravin, et le faubourg offrait encore des rues tortueuses, grimpantes, d’un effet original, et des groupes d’anciennes constructions assez pittoresques.
Quand le destin m’y amena, je mis pied à terre avant d’arriver, et, m’étant enquis du nom de l’hôtel où le conducteur de la diligence déposerait mon bagage, j’entrai seul et pédestrement dans la ville.
J’avais une lettre de recommandation, une seule, et pour cause. Je ne m’occupai pas de mon gîte ; je demandai la place de la Comédie (vieux style), on dit aujourd’hui la place de la Maison-de-Ville, bien que le théâtre, la mairie et le tribunal vivent encore en bonne intelligence sous le même toit.
— C’est toujours tout droit, répondit-on.
Et, en effet, je me trouvai, au bout d’une longue rue, sur la place en question. Elle n’était pas grande : la maison de ville au fond, une maison bourgeoise à droite, un café à gauche. C’est à ce café que j’avais affaire.
Un grand et gros homme blond, jeune, d’une belle figure, agréable et douce, allait et venait d’une table à l’autre, tutoyant la plupart des consommateurs de son âge, tutoyé par ceux qui paraissaient avoir atteint la cinquantaine. Je demandai à la servante, qui m’indiquait une table vacante, où était le propriétaire de l’établissement, M. Narcisse Pardoux. J’avais à dessein prononcé son nom en le regardant. Il m’entendit malgré le grand bruit qui se faisait dans le billard, dont les portes ouvertes envoyaient jusqu’à nous d’épais nuages de fumée de pipe, et, sans paraître se distraire de ses nombreux consommateurs, il vint à moi et me dit en se penchant :
— Êtes-vous M. E…, de la part de M. T… ?
À quoi je répondis à voix basse :
— Je suis M. E… et je vous apporte une lettre de M. T…
— C’est bien, reprit-il.
Et, appelant Jeannette :
— Conduisez monsieur au jardin, lui dit-il tout bas.
Je suivis Jeannette, qui me fit traverser une petite rue derrière la maison. Elle poussa une porte et se retira en disant :
— M. Narcisse va venir.
J’étais entré dans un jardin bien fleuri et bien tenu. Il y avait, à gauche, une sorte de boulingrin planté d’arbustes, et surmonté d’un kiosque qui semblait approprié au même usage que le café d’où je sortais.
M. Pardoux vint me rejoindre presque aussitôt et me fit monter dans ce kiosque, sorte de tente couverte en zinc, où Jeannette nous apporta de la bière, des cigares et quelques liqueurs à choisir.
Je dirai très-succinctement le but de mon voyage dans cette ville, où je ne connaissais pas une âme. J’étais chargé, par le directeur d’une association de capitalistes sérieux, de faire des études sur la localité, en vue de l’établissement d’une exploitation industrielle d’une assez grande importance. M. Pardoux avait eu et suggéré cette idée, qui avait été traitée de rêve par les indigènes. Il s’était adressé à l’homme de progrès et d’intelligence dont je lui remettais la lettre. On m’envoyait vers lui pour qu’il me mît à même d’examiner son projet et d’en vérifier les chances de succès.
Il me les exposa avec beaucoup de logique et de clarté. Je reconnus vite en lui l’homme sans culture, mais doué du génie du bon sens, qui avait écrit plusieurs lettres remarquables à M. T…, mon directeur et mon ami, et, comme je me montrai disposé à le croire et à commencer mes études avec confiance, le bon Pardoux se livra à une joie enthousiaste.
— Enfin ! s’écria-t-il, voilà cinq ans que je m’époumone à dire à tous les gros bonnets de pays qu’il y a pour eux et pour les pauvres, une fortune dans mon idée. Et ils ne font que lever les épaules en répondant toujours :