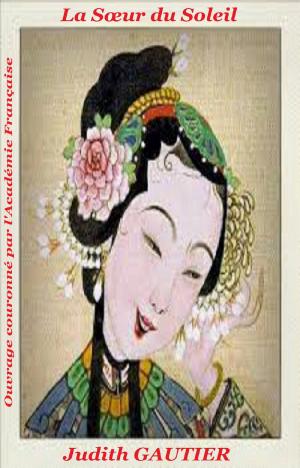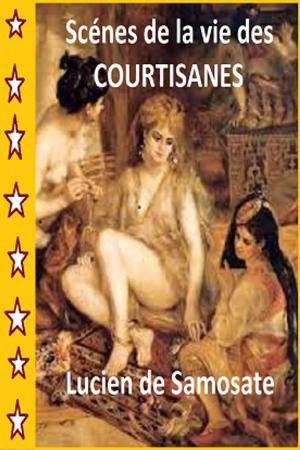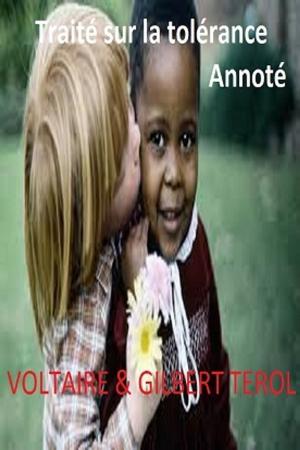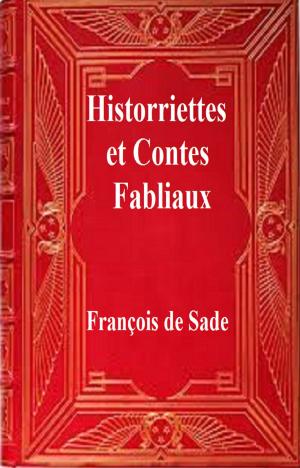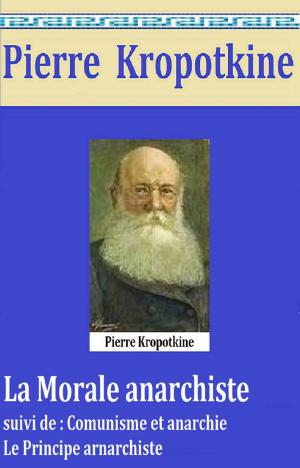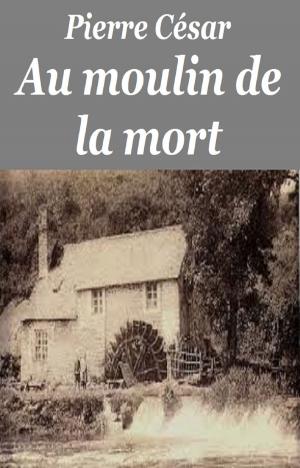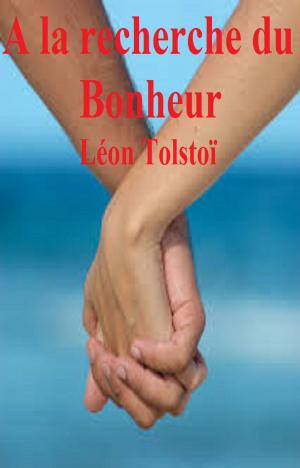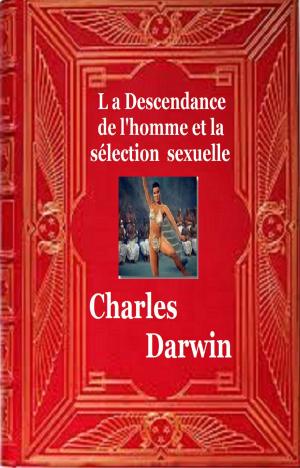| Author: | ROBERT LOUIS STEVENSON | ISBN: | 1230001111200 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | May 12, 2016 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | ROBERT LOUIS STEVENSON |
| ISBN: | 1230001111200 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | May 12, 2016 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Extrait :
Le 25 août 1751, vers deux heures de l’après-midi, moi, David Balfour, sortant de la Banque des Toiles Britanniques où je venais pour la première fois de toucher mes revenus, suivi d’un employé qui portait mon argent, je me vis saluer par les principaux commerçants qui, du seuil de leurs portes, me regardaient passer. Deux jours avant, et même pas plus tard que la veille au matin, je n’étais qu’un vagabond errant sur les chemins, vêtu de haillons et arrivé à mon dernier shilling. J’avais pour compagnon un proscrit, condamné pour rébellion et ma tête était mise à prix à cause d’un crime qui mettait tout le pays en rumeur. Aujourd’hui, je me trouvais tout à coup héritier des biens que je tenais de ma naissance, et même grand propriétaire. J’entrais dans la ville accompagnée du porteur chargé de mon argent, des lettres de recommandation plein mes poches, enfin, comme dit le proverbe, avec tous les atouts dans mon jeu.
Cette belle médaille avait malheureusement son revers ; d’une part, la difficile et dangereuse affaire que j’avais sur les bras ; d’autre part, l’endroit où je me trouvais. La grande ville noire, le nombre, le mouvement, le bruit des passants, tout m’apparaissait comme un monde nouveau après les marécages, les pentes abruptes et les calmes paysages qui m’étaient familiers. La foule des bourgeois surtout me déconcertait ; le fils de Rankeillor, qui m’avait passé ses habite, était petit et mince, ses vêtements joignaient à peine sur moi ; il était évident que je n’étais pas vêtu comme un rentier et je risquais d’attirer l’attention du public. Aussi, je résolus de me procurer sans retard des habits à ma taille et, en attendant, je me mis à marcher côte à côte avec mon porteur, lui glissant familièrement la main sous le bras comme si nous eussions été une paire d’amis.
J’allai d’abord me faire habiller chez un tailleur de Luckenbooths, sans luxe, car je ne voulais pas avoir l’air d’un mendiant enrichi, mais convenablement, afin d’être respecté. De là, je passai chez un armurier où je me munis d’une épée ordinaire et convenable à mon rang. Je me sentis aussitôt plus en sûreté avec cette arme, bien que, pour quelqu’un d’aussi ignorant que moi en matière d’escrime, ce fût plutôt un danger. Le porteur, qui était sans doute un homme de quelque expérience, jugea mon accoutrement réussi.
« Rien de voyant, me dit-il, mais un appareil simple et décent ; quant à la rapière, pas de doute qu’elle ne convienne à votre situation, mais si j’avais été à votre place, j’aurais fait un meilleur usage de mon argent. »
Et il me proposa de me conduire chez une de ses parentes qui confectionnait des culottes d’hiver inusables. Mais j’avais en tête des affaires autrement pressantes et il fallait m’orienter dans cette vieille ville fumeuse où je me trouvais pour la première fois, vraie garenne à lapins, soit par le nombre de ses habitants, soit par l’enchevêtrement de ses rues et de ses passages. C’était en vérité un endroit où un étranger ne pouvait se reconnaître et avait peu de chance de dénicher la demeure d’un ami étranger comme lui. Même en supposant qu’il arrivât à découvrir l’impasse cherchée, les gens vivent si entassés dans ces hautes vieilles maisons, qu’il pourrait bien courir tout un jour avant d’avoir la bonne fortune de frapper à la porte de son ami. Il y avait bien un moyen de se tirer d’affaire, c’était de prendre un guide qui vous menait où vous vouliez et ensuite vous ramenait chez vous ; seulement ces caddies ayant justement pour métier d’être très bien informés des personnes et des maisons de la ville, étaient devenus une vraie bande d’espions.
Extrait :
Le 25 août 1751, vers deux heures de l’après-midi, moi, David Balfour, sortant de la Banque des Toiles Britanniques où je venais pour la première fois de toucher mes revenus, suivi d’un employé qui portait mon argent, je me vis saluer par les principaux commerçants qui, du seuil de leurs portes, me regardaient passer. Deux jours avant, et même pas plus tard que la veille au matin, je n’étais qu’un vagabond errant sur les chemins, vêtu de haillons et arrivé à mon dernier shilling. J’avais pour compagnon un proscrit, condamné pour rébellion et ma tête était mise à prix à cause d’un crime qui mettait tout le pays en rumeur. Aujourd’hui, je me trouvais tout à coup héritier des biens que je tenais de ma naissance, et même grand propriétaire. J’entrais dans la ville accompagnée du porteur chargé de mon argent, des lettres de recommandation plein mes poches, enfin, comme dit le proverbe, avec tous les atouts dans mon jeu.
Cette belle médaille avait malheureusement son revers ; d’une part, la difficile et dangereuse affaire que j’avais sur les bras ; d’autre part, l’endroit où je me trouvais. La grande ville noire, le nombre, le mouvement, le bruit des passants, tout m’apparaissait comme un monde nouveau après les marécages, les pentes abruptes et les calmes paysages qui m’étaient familiers. La foule des bourgeois surtout me déconcertait ; le fils de Rankeillor, qui m’avait passé ses habite, était petit et mince, ses vêtements joignaient à peine sur moi ; il était évident que je n’étais pas vêtu comme un rentier et je risquais d’attirer l’attention du public. Aussi, je résolus de me procurer sans retard des habits à ma taille et, en attendant, je me mis à marcher côte à côte avec mon porteur, lui glissant familièrement la main sous le bras comme si nous eussions été une paire d’amis.
J’allai d’abord me faire habiller chez un tailleur de Luckenbooths, sans luxe, car je ne voulais pas avoir l’air d’un mendiant enrichi, mais convenablement, afin d’être respecté. De là, je passai chez un armurier où je me munis d’une épée ordinaire et convenable à mon rang. Je me sentis aussitôt plus en sûreté avec cette arme, bien que, pour quelqu’un d’aussi ignorant que moi en matière d’escrime, ce fût plutôt un danger. Le porteur, qui était sans doute un homme de quelque expérience, jugea mon accoutrement réussi.
« Rien de voyant, me dit-il, mais un appareil simple et décent ; quant à la rapière, pas de doute qu’elle ne convienne à votre situation, mais si j’avais été à votre place, j’aurais fait un meilleur usage de mon argent. »
Et il me proposa de me conduire chez une de ses parentes qui confectionnait des culottes d’hiver inusables. Mais j’avais en tête des affaires autrement pressantes et il fallait m’orienter dans cette vieille ville fumeuse où je me trouvais pour la première fois, vraie garenne à lapins, soit par le nombre de ses habitants, soit par l’enchevêtrement de ses rues et de ses passages. C’était en vérité un endroit où un étranger ne pouvait se reconnaître et avait peu de chance de dénicher la demeure d’un ami étranger comme lui. Même en supposant qu’il arrivât à découvrir l’impasse cherchée, les gens vivent si entassés dans ces hautes vieilles maisons, qu’il pourrait bien courir tout un jour avant d’avoir la bonne fortune de frapper à la porte de son ami. Il y avait bien un moyen de se tirer d’affaire, c’était de prendre un guide qui vous menait où vous vouliez et ensuite vous ramenait chez vous ; seulement ces caddies ayant justement pour métier d’être très bien informés des personnes et des maisons de la ville, étaient devenus une vraie bande d’espions.