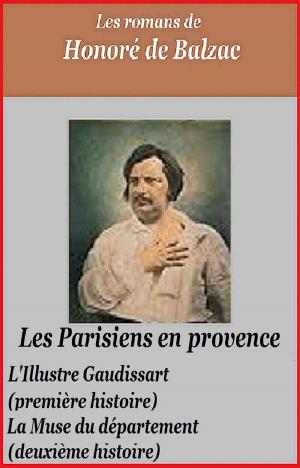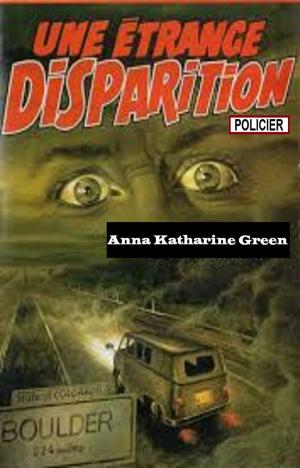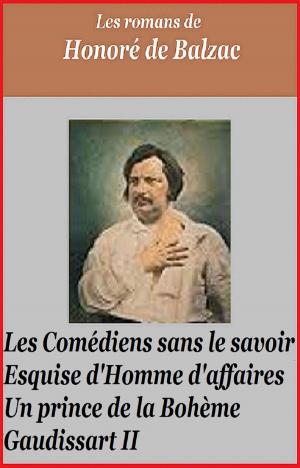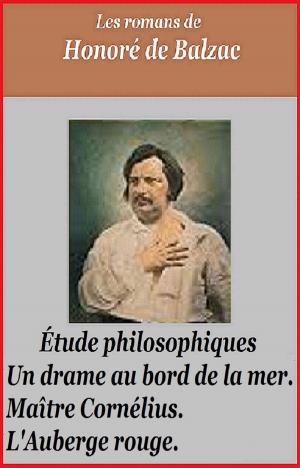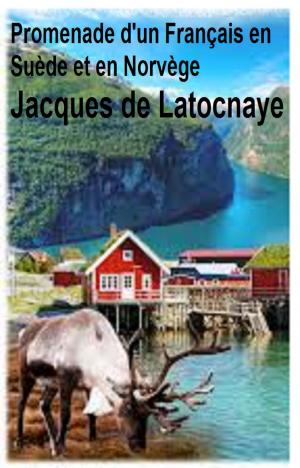| Author: | Édouard Rod | ISBN: | 1230002804613 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | November 6, 2018 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | Édouard Rod |
| ISBN: | 1230002804613 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | November 6, 2018 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Il y a des amitiés de jeunesse sur lesquelles le temps passe sans les détruire : il les ralentit, il les attiédit, il les diminue ; il ne les tue pas. On peut rester des mois sans se revoir, sans échanger une lettre, sans rien savoir l’un de l’autre ; pourtant on se retrouve tel que si l’on s’était quitté la veille. Chacun a vécu sa vie, dont l’autre ignore les péripéties : et, dès la première poignée de main qu’on échange, c’est comme si l’on avait, côte à côte, traversé les mêmes épreuves, vaincu les mêmes obstacles, accompli les mêmes efforts. Précieuses et rares sont ces amitiés, que, seule, la mort dénoue, et qui ne se remplacent pas.
Telle est celle qui m’unit encore à Philippe Nattier. Elle date de notre quatorzième année : du lycée de B***, où le hasard nous fit entrer le même jour et nous plaça à côté l’un de l’autre. J’étais embarrassé par un thème latin, qui me semblait extrêmement difficile : étant plus « fort », il me vint en aide ; après quoi, nous passâmes deux ans sans nous quitter.
Au temps de notre adolescence, Philippe Nattier, avec ses grands yeux noirs, son front intelligent, ses traits réguliers et purs, était un garçon silencieux, presque morose, qui s’enfermait en lui-même, ne parlait à personne de ses affaires intimes, s’intéressait aux idées abstraites, et professait un profond mépris pour tout ce qui touche à la vie pratique. Il n’a point changé. Maintenant, il approche de la quarantaine ; quelques cheveux blancs se montrent au-dessus de ses tempes, qui commencent à se dégarnir ; sa forte barbe noire, dont il était justement fier, est déjà toute grise. Et quand je le rencontre, bien qu’à des intervalles éloignés, je retrouve, sous l’homme mûr et vigoureux, l’enfant qui fut mon camarade, l’adolescent qui fut mon ami. Nous passons des heures charmantes, pendant lesquelles nous parlons peu et pensons ensemble. Il n’a plus cette beauté qui, jadis, arrêtait les regards des femmes, mais sa figure a conservé tout son caractère : énergique et doux à la fois, pensif, bienveillant avec une pointe d’ironie. Il a dans les yeux cette lueur indéfinissable qui semble le reflet de trop de réflexions, de trop de voyages autour de soi-même dont le retour est rempli d’incurables mélancolies : car il a beaucoup vécu seul. Son cercle d’observation est demeuré borné ; mais, s’il a vu peu de gens, il les a bien vus ; s’il connaît peu de choses, il les connaît bien : pour s’être exercé sur un panorama restreint, son coup d’œil n’en est ni moins pénétrant, ni moins sûr.
Quand nous étions ensemble sur les bancs de l’école, pendant les récréations ou les promenades, j’aimais à lui raconter ma vie, toute simplette, dont les moindres incidents prenaient pour nous un relief extraordinaire. Lui, ne me disait à peu près rien de la sienne. À peine parlait-il quelquefois de ses parents, qui vinrent le voir de temps en temps, et dont j’aperçus les rapides silhouettes. Je le savais fils unique d’un médecin fort habile, établi dans la petite ville des Pleiges, dans le Jura. Une fois, à la rentrée des grandes vacances, il revint en deuil : sa mère était morte. Je lui demandai :
— Tu as beaucoup de chagrin ?
Il me répondit, avec un tremblement dans la voix :
— Oui, beaucoup.
Il ajouta, les yeux perdus, d’un ton pénétré :
— Ma mère était très, très bonne !
Et ce fut tout.
D’où venait cette extrême réserve ? Les uns l’attribuaient à une dureté d’âme dont les raideurs d’attitude de Philippe semblaient témoigner. Mais je savais bien, moi, que mon ami n’était point insensible, qu’au contraire son âme vibrait et frémissait aux moindres chocs, qu’il portait en lui un monde de sensations dont la vivacité allait parfois jusqu’à la violence, et que, seul, le masque restait impassible. Ce que j’ai connu plus tard de sa vie ne m’a point expliqué non plus sa retenue presque sauvage, qui découragea bien des sympathies. Je crois donc qu’il faut simplement l’attribuer à son caractère : il était réservé comme d’autres sont expansifs, mélancolique comme d’autres sont gais ; peut-être qu’il devait ces traits à la nature de son pays natal, à cet âpre Jura froid, triste, monotone, où la voix des oiseaux s’étouffe dans les bois sourds, où la bise gémit à travers les sapins et glace les vallées, où la neige enveloppe les horizons, pendant de longs mois, comme un linceul de mort. Quelles que fussent les causes de sa manière d’être, elle l’empêcha d’avoir d’autre ami que moi. Je l’en aimai davantage. On nous citait, dans les classes, comme doublures d’Oreste et de Pylade. Aux récréations, nous avions toujours d’importants secrets à nous communiquer dans des coins ; aux heures de classe, nous trouvions mille moyens de nous entr’aider : je crois bien que chacun de nous a toujours ignoré certaines choses que l’autre apprenait pour lui, et que la réussite de notre bachot fut celle d’une entreprise collective.
Aussi fut-ce un déchirement quand il fallut nous séparer, Philippe devant faire sa médecine, moi mon droit. Arrivés ensemble à Paris, nous nous promîmes de nous voir au moins tous les jours, pour nous consoler de ne plus travailler ensemble.
Il y a des amitiés de jeunesse sur lesquelles le temps passe sans les détruire : il les ralentit, il les attiédit, il les diminue ; il ne les tue pas. On peut rester des mois sans se revoir, sans échanger une lettre, sans rien savoir l’un de l’autre ; pourtant on se retrouve tel que si l’on s’était quitté la veille. Chacun a vécu sa vie, dont l’autre ignore les péripéties : et, dès la première poignée de main qu’on échange, c’est comme si l’on avait, côte à côte, traversé les mêmes épreuves, vaincu les mêmes obstacles, accompli les mêmes efforts. Précieuses et rares sont ces amitiés, que, seule, la mort dénoue, et qui ne se remplacent pas.
Telle est celle qui m’unit encore à Philippe Nattier. Elle date de notre quatorzième année : du lycée de B***, où le hasard nous fit entrer le même jour et nous plaça à côté l’un de l’autre. J’étais embarrassé par un thème latin, qui me semblait extrêmement difficile : étant plus « fort », il me vint en aide ; après quoi, nous passâmes deux ans sans nous quitter.
Au temps de notre adolescence, Philippe Nattier, avec ses grands yeux noirs, son front intelligent, ses traits réguliers et purs, était un garçon silencieux, presque morose, qui s’enfermait en lui-même, ne parlait à personne de ses affaires intimes, s’intéressait aux idées abstraites, et professait un profond mépris pour tout ce qui touche à la vie pratique. Il n’a point changé. Maintenant, il approche de la quarantaine ; quelques cheveux blancs se montrent au-dessus de ses tempes, qui commencent à se dégarnir ; sa forte barbe noire, dont il était justement fier, est déjà toute grise. Et quand je le rencontre, bien qu’à des intervalles éloignés, je retrouve, sous l’homme mûr et vigoureux, l’enfant qui fut mon camarade, l’adolescent qui fut mon ami. Nous passons des heures charmantes, pendant lesquelles nous parlons peu et pensons ensemble. Il n’a plus cette beauté qui, jadis, arrêtait les regards des femmes, mais sa figure a conservé tout son caractère : énergique et doux à la fois, pensif, bienveillant avec une pointe d’ironie. Il a dans les yeux cette lueur indéfinissable qui semble le reflet de trop de réflexions, de trop de voyages autour de soi-même dont le retour est rempli d’incurables mélancolies : car il a beaucoup vécu seul. Son cercle d’observation est demeuré borné ; mais, s’il a vu peu de gens, il les a bien vus ; s’il connaît peu de choses, il les connaît bien : pour s’être exercé sur un panorama restreint, son coup d’œil n’en est ni moins pénétrant, ni moins sûr.
Quand nous étions ensemble sur les bancs de l’école, pendant les récréations ou les promenades, j’aimais à lui raconter ma vie, toute simplette, dont les moindres incidents prenaient pour nous un relief extraordinaire. Lui, ne me disait à peu près rien de la sienne. À peine parlait-il quelquefois de ses parents, qui vinrent le voir de temps en temps, et dont j’aperçus les rapides silhouettes. Je le savais fils unique d’un médecin fort habile, établi dans la petite ville des Pleiges, dans le Jura. Une fois, à la rentrée des grandes vacances, il revint en deuil : sa mère était morte. Je lui demandai :
— Tu as beaucoup de chagrin ?
Il me répondit, avec un tremblement dans la voix :
— Oui, beaucoup.
Il ajouta, les yeux perdus, d’un ton pénétré :
— Ma mère était très, très bonne !
Et ce fut tout.
D’où venait cette extrême réserve ? Les uns l’attribuaient à une dureté d’âme dont les raideurs d’attitude de Philippe semblaient témoigner. Mais je savais bien, moi, que mon ami n’était point insensible, qu’au contraire son âme vibrait et frémissait aux moindres chocs, qu’il portait en lui un monde de sensations dont la vivacité allait parfois jusqu’à la violence, et que, seul, le masque restait impassible. Ce que j’ai connu plus tard de sa vie ne m’a point expliqué non plus sa retenue presque sauvage, qui découragea bien des sympathies. Je crois donc qu’il faut simplement l’attribuer à son caractère : il était réservé comme d’autres sont expansifs, mélancolique comme d’autres sont gais ; peut-être qu’il devait ces traits à la nature de son pays natal, à cet âpre Jura froid, triste, monotone, où la voix des oiseaux s’étouffe dans les bois sourds, où la bise gémit à travers les sapins et glace les vallées, où la neige enveloppe les horizons, pendant de longs mois, comme un linceul de mort. Quelles que fussent les causes de sa manière d’être, elle l’empêcha d’avoir d’autre ami que moi. Je l’en aimai davantage. On nous citait, dans les classes, comme doublures d’Oreste et de Pylade. Aux récréations, nous avions toujours d’importants secrets à nous communiquer dans des coins ; aux heures de classe, nous trouvions mille moyens de nous entr’aider : je crois bien que chacun de nous a toujours ignoré certaines choses que l’autre apprenait pour lui, et que la réussite de notre bachot fut celle d’une entreprise collective.
Aussi fut-ce un déchirement quand il fallut nous séparer, Philippe devant faire sa médecine, moi mon droit. Arrivés ensemble à Paris, nous nous promîmes de nous voir au moins tous les jours, pour nous consoler de ne plus travailler ensemble.