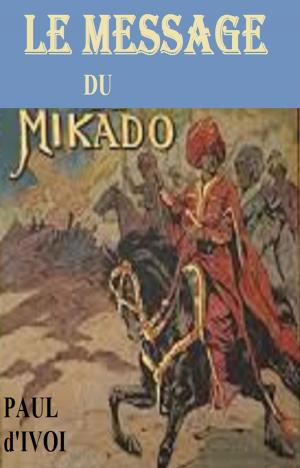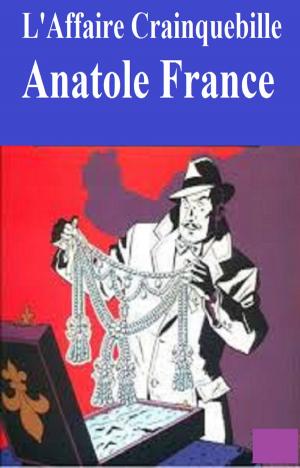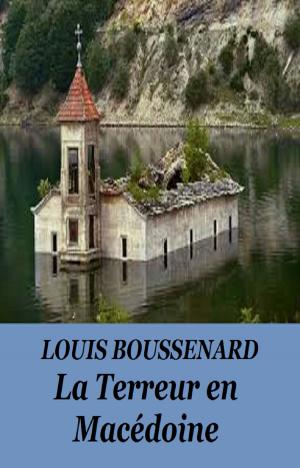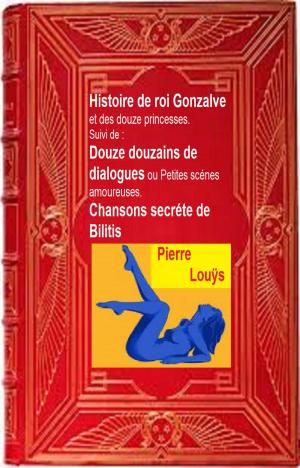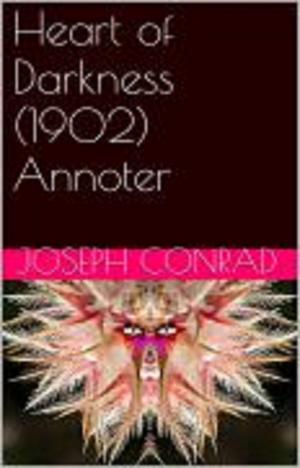| Author: | JEAN JAURÈS | ISBN: | 1230002767406 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | October 31, 2018 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | JEAN JAURÈS |
| ISBN: | 1230002767406 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | October 31, 2018 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Dans le vif et fin récit que Georges Renard nous a donné, notre savant camarade a raconté comment s’était fait le coup d’État ; il en a fixé les péripéties ; il a bien marqué comment ce coup de force était l’aboutissant logique de la longue lutte engagée dès le milieu de 1850 pour savoir qui, des monarchistes ou des napoléoniens, de la majorité ou du président, s’emparerait de la France.
Les faits sont désormais assez connus. Il nous suffira de noter ce qui, dans ces journées funestes, annonce le nouveau régime, annonce ce second Empire, dont nous avons à décrire la singulière évolution.
Quand le coup fut fait, on s’en souvient, il y avait plus de dix mois que le président et ses complices travaillaient à leur projet : tout avait été merveilleusement préparé.
Depuis la crise ministérielle d’octobre, les amis, les complices de Louis Napoléon occupaient déjà le ministère : Saint-Arnaud était à la guerre ; M. de Maupas, préfet de la Haute-Garonne avait remplacé Carlier à la préfecture de police (on sait comment celui-là entendait les garanties à donner aux accusés). L’armée avait été suffisamment travaillée ; le général Magnan, depuis le 15 juillet commandant en chef de l’armée de Paris, avait gagné à la cause du prince les officiers généraux placés sous ses ordres ; les banquets de l’Élysée avaient fait le reste : le 15 septembre, un état fourni par le ministère de la guerre, avait donné des renseignements complets sur l’esprit des officiers et celui des troupes. Armée, police, fonctionnaires, le président disposait de toutes les forces qui, dans une nation centralisée, assurent le succès à un Coup d’État. Enfin, le moment favorable était venu : la proposition, faite par le président dans son message, d’abroger la loi du 31 mai 1850, avait pu faire oublier que c’était son gouvernement, que c’était son propre ministère qui, naguère, avait proposé cette mutilation du suffrage universel. Au milieu des bruits, habilement entretenus, de complot royaliste, la proposition des questeurs « avait, comme disait Magnan, donné barre » à l’Élysée contre la majorité de l’Assemblée. Et d’autre part, le fait même que la proposition avait été repoussée avait contribué à apaiser la crainte d’un coup d’État qui tourmentait l’opinion. L’ancien carbonaro qui, selon la très juste expression de M. Tchernoff, avait organisé « une société secrète au sommet de l’État » allait pouvoir tenter son coup.
Donc, dans la nuit du 1er au 2 décembre une compagnie de gendarmerie mobile occupa l’Imprimerie nationale. Sous la surveillance de deux agents de police, les typographes, premiers auteurs involontaires de la violation de la loi, durent imprimer les proclamations. Cependant, M. Vieyra, avait fait crever les tambours de la garde nationale. Et M. de Maupas, avec ses quarante commissaires, unanimement dédaigneux de la constitution, lançait des mandats d’arrêt.
Au matin, le palais de l’Assemblée était occupé. 25.000 hommes d’infanterie, 6.000 cavaliers ou artilleurs prenaient position entre la Chambre et l’Élysée. M. Baze, questeur de l’Assemblée, le général Changarnier, le général Bedeau, le général Lamoricière, le général Cavaignac, M. Thiers étaient arrêtés avant le jour. Arrêtés également les représentants républicains : Charras, Greppo, l’honnête et brave ouvrier lyonnais, qui seul, naguère, avait voté avec Proudhon ; Valentin, le lieutenant ; Martin Nadaud, le maçon, représentant de la Creuse ; Beaune ; Cholat ; Lagrange ; Miot ; Roger (du Nord). Arrêtés enfin les hommes du peuple connus pour leur ardeur républicaine, les militants, redoutés « comme chefs de barricades ». Il y en eut soixante-dix-huit qu’on conduisit à Mazas. La besogne policière était terminée le 2, à sept heures du matin.
À la même heure, les afficheurs de la préfecture de police avaient fini de placarder, sur tous les murs de Paris, les pièces qui annonçaient le coup d’État[1].
D’abord un décret, déclarant l’assemblée nationale dissoute, le suffrage universel rétabli, la loi du 31 mars abrogée, et convoquant le peuple français dans ses comices, du 14 décembre au 21. Ensuite une proclamation du président de la République, un appel au peuple.
Il faut analyser cet appel. S’il est vrai que Louis-Napoléon ait eu du coup d’État, une conception, à lui, une conception que les événements ou les passions des diverses classes l’ont contraint de déformer ou dépasser, c’est dans l’appel, rédigé avant même qu’il ne connût toutes les conséquences de son coup, qu’il faut chercher cette conception.
Le président justifie d’abord la dissolution de l’Assemblée. « L’Assemblée, qui devait être le plus ferme appui de l’ordre, est devenue un foyer de complots. Le patriotisme de trois cents de ses membres n’a pu arrêter ses fatales tendances. Au lieu de faire des lois dans l’intérêt général, elle forge des armes pour la guerre civile… Je l’ai dissoute, et je rends le peuple entier juge entre elle et moi ».
En second lieu, le président réclame du peuple des pouvoirs plus étendus. « La Constitution, dit-il, vous le savez, avait été faite dans le but d’affaiblir d’avance le pouvoir que vous alliez me confier. Six millions de suffrages furent une éclatante protestation contre elle, et cependant je l’ai fidèlement observée ».
Mais le pacte fondamental n’est plus respecté de ceux-là même qui l’invoquent sans cesse : ils songent « après avoir perdu deux monarchies » à lier les mains du président, afin de renverser la République. Pour maintenir la République et sauver le pays, le président demande donc au peuple de nouveaux pouvoirs. Il lui demande « les moyens d’accomplir la grande mission qu’il tient de lui ». Cette mission, elle « consiste à fermer l’ère des révolutions, en satisfaisant les besoins légitimes du peuple, et en le protégeant contre les passions subversives. Elle consiste surtout à créer des institutions qui survivent aux hommes et qui soient enfin des fondations sur lesquelles on puisse asseoir quelque chose de durable ».
Il faut par une nouvelle constitution, créer un pouvoir stable. Les bases fondamentales de cette constitution doivent donc être les suivantes :
Dans le vif et fin récit que Georges Renard nous a donné, notre savant camarade a raconté comment s’était fait le coup d’État ; il en a fixé les péripéties ; il a bien marqué comment ce coup de force était l’aboutissant logique de la longue lutte engagée dès le milieu de 1850 pour savoir qui, des monarchistes ou des napoléoniens, de la majorité ou du président, s’emparerait de la France.
Les faits sont désormais assez connus. Il nous suffira de noter ce qui, dans ces journées funestes, annonce le nouveau régime, annonce ce second Empire, dont nous avons à décrire la singulière évolution.
Quand le coup fut fait, on s’en souvient, il y avait plus de dix mois que le président et ses complices travaillaient à leur projet : tout avait été merveilleusement préparé.
Depuis la crise ministérielle d’octobre, les amis, les complices de Louis Napoléon occupaient déjà le ministère : Saint-Arnaud était à la guerre ; M. de Maupas, préfet de la Haute-Garonne avait remplacé Carlier à la préfecture de police (on sait comment celui-là entendait les garanties à donner aux accusés). L’armée avait été suffisamment travaillée ; le général Magnan, depuis le 15 juillet commandant en chef de l’armée de Paris, avait gagné à la cause du prince les officiers généraux placés sous ses ordres ; les banquets de l’Élysée avaient fait le reste : le 15 septembre, un état fourni par le ministère de la guerre, avait donné des renseignements complets sur l’esprit des officiers et celui des troupes. Armée, police, fonctionnaires, le président disposait de toutes les forces qui, dans une nation centralisée, assurent le succès à un Coup d’État. Enfin, le moment favorable était venu : la proposition, faite par le président dans son message, d’abroger la loi du 31 mai 1850, avait pu faire oublier que c’était son gouvernement, que c’était son propre ministère qui, naguère, avait proposé cette mutilation du suffrage universel. Au milieu des bruits, habilement entretenus, de complot royaliste, la proposition des questeurs « avait, comme disait Magnan, donné barre » à l’Élysée contre la majorité de l’Assemblée. Et d’autre part, le fait même que la proposition avait été repoussée avait contribué à apaiser la crainte d’un coup d’État qui tourmentait l’opinion. L’ancien carbonaro qui, selon la très juste expression de M. Tchernoff, avait organisé « une société secrète au sommet de l’État » allait pouvoir tenter son coup.
Donc, dans la nuit du 1er au 2 décembre une compagnie de gendarmerie mobile occupa l’Imprimerie nationale. Sous la surveillance de deux agents de police, les typographes, premiers auteurs involontaires de la violation de la loi, durent imprimer les proclamations. Cependant, M. Vieyra, avait fait crever les tambours de la garde nationale. Et M. de Maupas, avec ses quarante commissaires, unanimement dédaigneux de la constitution, lançait des mandats d’arrêt.
Au matin, le palais de l’Assemblée était occupé. 25.000 hommes d’infanterie, 6.000 cavaliers ou artilleurs prenaient position entre la Chambre et l’Élysée. M. Baze, questeur de l’Assemblée, le général Changarnier, le général Bedeau, le général Lamoricière, le général Cavaignac, M. Thiers étaient arrêtés avant le jour. Arrêtés également les représentants républicains : Charras, Greppo, l’honnête et brave ouvrier lyonnais, qui seul, naguère, avait voté avec Proudhon ; Valentin, le lieutenant ; Martin Nadaud, le maçon, représentant de la Creuse ; Beaune ; Cholat ; Lagrange ; Miot ; Roger (du Nord). Arrêtés enfin les hommes du peuple connus pour leur ardeur républicaine, les militants, redoutés « comme chefs de barricades ». Il y en eut soixante-dix-huit qu’on conduisit à Mazas. La besogne policière était terminée le 2, à sept heures du matin.
À la même heure, les afficheurs de la préfecture de police avaient fini de placarder, sur tous les murs de Paris, les pièces qui annonçaient le coup d’État[1].
D’abord un décret, déclarant l’assemblée nationale dissoute, le suffrage universel rétabli, la loi du 31 mars abrogée, et convoquant le peuple français dans ses comices, du 14 décembre au 21. Ensuite une proclamation du président de la République, un appel au peuple.
Il faut analyser cet appel. S’il est vrai que Louis-Napoléon ait eu du coup d’État, une conception, à lui, une conception que les événements ou les passions des diverses classes l’ont contraint de déformer ou dépasser, c’est dans l’appel, rédigé avant même qu’il ne connût toutes les conséquences de son coup, qu’il faut chercher cette conception.
Le président justifie d’abord la dissolution de l’Assemblée. « L’Assemblée, qui devait être le plus ferme appui de l’ordre, est devenue un foyer de complots. Le patriotisme de trois cents de ses membres n’a pu arrêter ses fatales tendances. Au lieu de faire des lois dans l’intérêt général, elle forge des armes pour la guerre civile… Je l’ai dissoute, et je rends le peuple entier juge entre elle et moi ».
En second lieu, le président réclame du peuple des pouvoirs plus étendus. « La Constitution, dit-il, vous le savez, avait été faite dans le but d’affaiblir d’avance le pouvoir que vous alliez me confier. Six millions de suffrages furent une éclatante protestation contre elle, et cependant je l’ai fidèlement observée ».
Mais le pacte fondamental n’est plus respecté de ceux-là même qui l’invoquent sans cesse : ils songent « après avoir perdu deux monarchies » à lier les mains du président, afin de renverser la République. Pour maintenir la République et sauver le pays, le président demande donc au peuple de nouveaux pouvoirs. Il lui demande « les moyens d’accomplir la grande mission qu’il tient de lui ». Cette mission, elle « consiste à fermer l’ère des révolutions, en satisfaisant les besoins légitimes du peuple, et en le protégeant contre les passions subversives. Elle consiste surtout à créer des institutions qui survivent aux hommes et qui soient enfin des fondations sur lesquelles on puisse asseoir quelque chose de durable ».
Il faut par une nouvelle constitution, créer un pouvoir stable. Les bases fondamentales de cette constitution doivent donc être les suivantes :