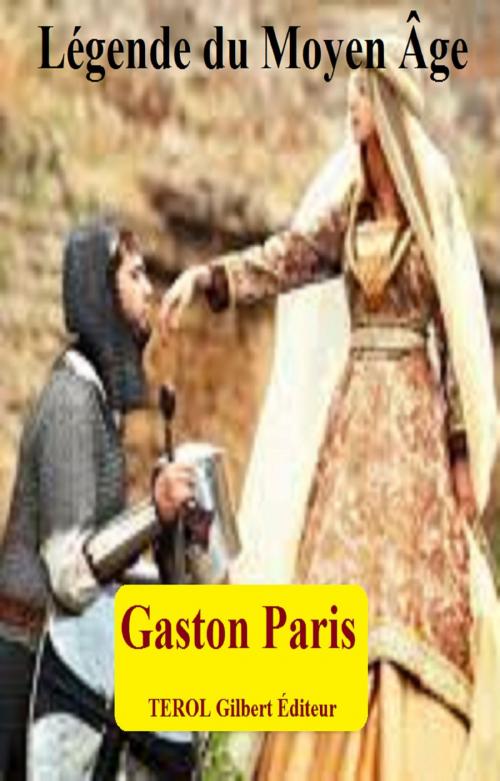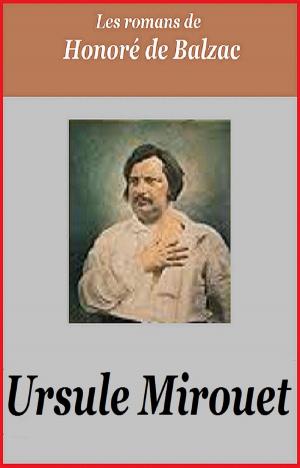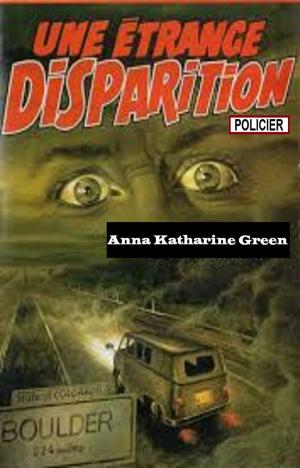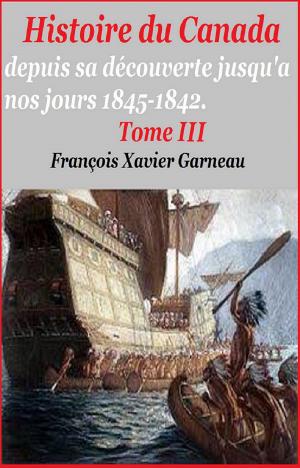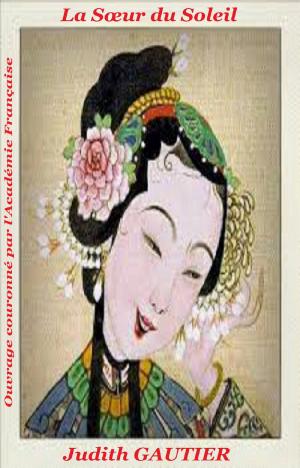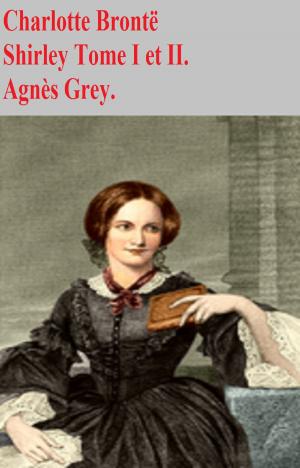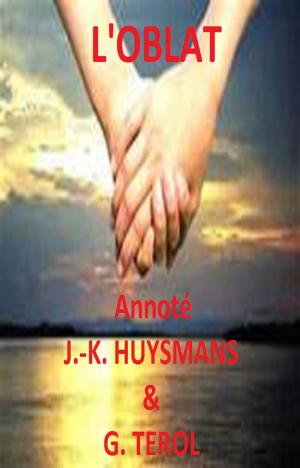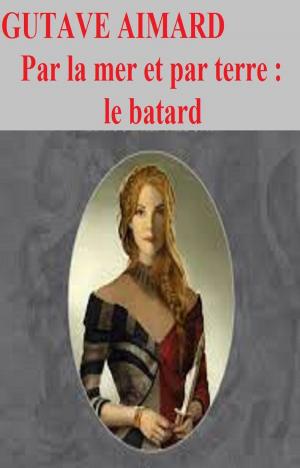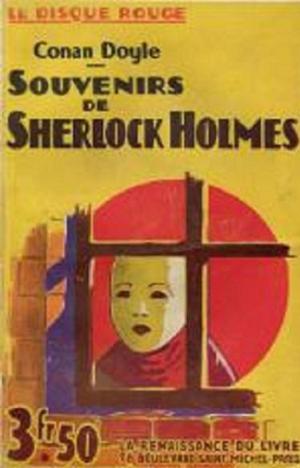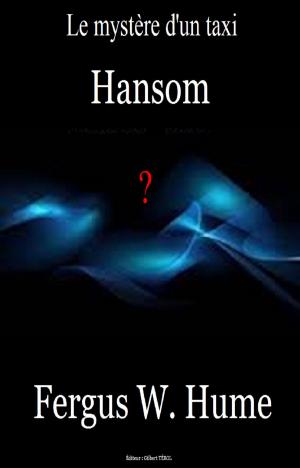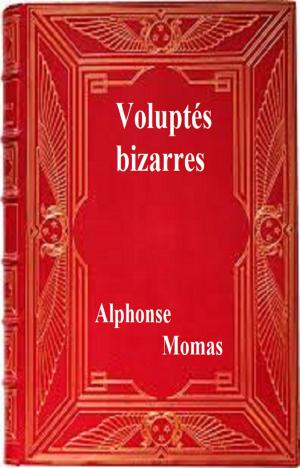| Author: | GASTON PARIS | ISBN: | 1230002753560 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | October 28, 2018 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | GASTON PARIS |
| ISBN: | 1230002753560 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | October 28, 2018 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Le 15 août 778, l’arrière-garde de l’armée que le roi des Francs, Charles, ramenait d’Espagne après une expédition à moitié heureuse fut surprise, dans les Pyrénées, par les Basques navarrais, — avec lesquels les Francs n’étaient pas en guerre ouverte, — et entièrement détruite. Le roi, qui avait déjà franchi les ports[1], retourna en toute hâte sur ses pas ; mais la nuit tombait quand il parvint au lieu du désastre : les montagnards s’étaient dispersés, et on ne pouvait même savoir où les poursuivre. Charles — que rappelait un soulèvement des Saxons — dut reprendre le chemin de France sans avoir vengé son arrière-garde ni reconquis le bagage qu’elle escortait et qui avait été complètement pillé.
Telle est la version que donnent les Annales royales et la Vie de Charlemagne d’Einhard ; c’est celle qu’ont adoptée tous nos historiens. La version arabe est toute différente : d’après Ibn-al-Athîr, — qui écrivait au commencement du xiiie siècle, mais qui puisait à des sources anciennes, — ce furent les musulmans de Saragosse — ceux-là mêmes qui avaient appelé Charles en Espagne — qui firent subir à l’armée franque, lorsqu’elle était hors du territoire arabe et se croyait en pleine sûreté, le grave échec dont il s’agit. Il faut probablement combiner ce récit avec celui des historiographes francs, et admettre que les musulmans excitèrent et aidèrent les Basques. Ils n’ont pas mentionné dans leur récit le concours que ceux-ci leur avaient prêté, et d’autre part les historiens officiels de l’empire franc, qui présentent comme beaucoup plus heureuse qu’elle ne le fut l’expédition de Charles en Espagne, n’ont pas voulu avouer que les auteurs du désastre étaient, au moins en partie, les « Sarrasins », — censés alliés des Francs, — et que le roi n’avait pu même essayer de tirer vengeance de leur perfidie. Ils ont mieux aimé ne parler que d’une surprise des Basques, dont l’impunité, causée par leur dispersion dans leurs montagnes, n’infligeait pas à l’honneur franc une aussi sensible humiliation.
Quoi qu’il en soit, ce funeste événement affecta très péniblement le roi. Les Annales quasi officielles, rédigées peu de temps après, sans doute sous les yeux de Charles, terminent ainsi le récit du triste épisode : « Le souvenir de cette blessure effaça presque entièrement, dans le cœur du roi, la satisfaction des succès qu’il avait obtenus en Espagne. » On peut croire que cette phrase fut dictée à l’analyste par le roi lui-même : elle tranche, par sa note intime et personnelle, avec la sécheresse habituelle des Annales ; et quel autre que Charles aurait pu révéler ainsi les sentiments de son grand cœur ?
La douleur et la colère du roi furent partagées par son armée, puis, bientôt, par la nation tout entière. On conçoit que l’émotion ait été grande : ce qui surprend, c’est qu’elle ait été aussi durable, ait survécu pendant des siècles, et se soit propagée bien au-delà du pays où elle avait été ressentie. Le massacre d’un corps d’armée dans une embuscade n’est après tout qu’un fait de guerre comme il s’en produit souvent, comme l’histoire de tous les pays militaires, et celle de la France en particulier, en comptent par centaines. Combien, depuis lors, avons-nous essuyé de défaites plus sanglantes et surtout plus graves dans leurs conséquences ! Elles sont oubliées cependant, — sauf les plus récentes, — ou le souvenir n’en est conservé que dans les livres et n’émeut que les lecteurs français, il en est tout autrement de celle du 15 août 778. Le nom du lieu qui vit la fatale déroute, Roncevaux, en évoque jusqu’à aujourd’hui le funèbre souvenir dans les âmes. Le nom de Roland, — l’un des trois chefs mentionnés par Einhard parmi les victimes des Basques, — est encore populaire non seulement en France, mais dans l’Europe presque entière ; sa mort a fait verser des larmes à trente générations après celle qui l’avait connu ; son image a été dressée sous le porche des églises, peinte sur leurs murailles ou leurs verrières ; elle s’est élevée ou s’élève encore, symbole de justice et de liberté, sur la place publique de nombreuses villes saxonnes…
Comment s’expliquent cette survivance extraordinaire et cette propagation incomparable du souvenir d’un événement et d’un personnage qui semblaient ne devoir intéresser qu’une époque et qu’un pays ?
C’est que la France était alors en pleine activité épique : les événements ou les personnages qui frappaient l’imagination des hommes appartenant à la classe guerrière étaient aussitôt l’objet de chants qui, originaires d’un point quelconque, se répandaient promptement, grâce aux « jongleurs », — ces aèdes du moyen âge, — dans le tout entier, s’adaptaient aux dialectes divers, et s’accroissaient dans leur marche comme les ondes formées par un choc vont s’élargissant autour de leur centre. L’épopée française — qui avait commencé dès l’époque mérovingienne — fut en pleine vie jusque vers la fin du Xe siècle. Les nouveaux chants qui surgissaient sans cesse ne faisaient pas oublier les anciens quand ceux-ci, par quelque circonstance particulière, méritaient de survivre : une génération les transmettait à l’autre, en les renouvelant pour le langage, en les modifiant et les amplifiant avec plus ou moins de bonheur. La chanson de geste consacrée à Roland, — née sans doute dans la Bretagne française, dont il était comte, puis répandue par la France entière, — traversa ainsi toute l’époque carolingienne. Au XIe siècle, elle existait sous des formes diverses, toutes, naturellement, assez éloignées de la première. De deux de ces formes nous avons d’imparfaits représentants dans un roman latin (la chronique attribuée à l’archevêque Turpin) et un poème latin en mauvais vers. D’autres ont laissé des traces dans les allusions de quelques poèmes français ou italiens, La plus éloignée de l’original, entre celles dont nous pouvons nous faire une idée, est probablement celle qui fut fixée vers 1080 : c’est la Chanson de Roland que, malgré plus d’une incertitude, nous possédons à peu près telle qu’elle fut alors rédigée ; elle fut, vers la fin du XIIe siècle, l’objet d’un « renouvellement » où l’on substitua la rime à l’assonance. Grâce à l’incomparable ascendant qu’exerçaient alors sur tout le monde occidental la culture et la poésie françaises, la Chanson de Roland fut traduite ou adaptée partout : en Espagne, où elle suscita l’épopée nationale (cantares degesta) ; en Italie, où elle était populaire dès le XIe siècle, et où elle aboutit, par une étrange déviation, aux poèmes de Boiardo et d’Arioste ; en Angleterre, où elle a été mise en anglais et même en gallois ; en Allemagne, où elle fut traduite en vers dès 1133 ; dans les Pays-Bas, où elle a été plus d’une fois, et d’après diverses rédactions, imitée en prose et en vers ; en Scandinavie, où, mise en prose norvégienne au XIIIe siècle, elle fait l’objet de livrets restés populaires en Danemark et jusqu’en Islande.
Le 15 août 778, l’arrière-garde de l’armée que le roi des Francs, Charles, ramenait d’Espagne après une expédition à moitié heureuse fut surprise, dans les Pyrénées, par les Basques navarrais, — avec lesquels les Francs n’étaient pas en guerre ouverte, — et entièrement détruite. Le roi, qui avait déjà franchi les ports[1], retourna en toute hâte sur ses pas ; mais la nuit tombait quand il parvint au lieu du désastre : les montagnards s’étaient dispersés, et on ne pouvait même savoir où les poursuivre. Charles — que rappelait un soulèvement des Saxons — dut reprendre le chemin de France sans avoir vengé son arrière-garde ni reconquis le bagage qu’elle escortait et qui avait été complètement pillé.
Telle est la version que donnent les Annales royales et la Vie de Charlemagne d’Einhard ; c’est celle qu’ont adoptée tous nos historiens. La version arabe est toute différente : d’après Ibn-al-Athîr, — qui écrivait au commencement du xiiie siècle, mais qui puisait à des sources anciennes, — ce furent les musulmans de Saragosse — ceux-là mêmes qui avaient appelé Charles en Espagne — qui firent subir à l’armée franque, lorsqu’elle était hors du territoire arabe et se croyait en pleine sûreté, le grave échec dont il s’agit. Il faut probablement combiner ce récit avec celui des historiographes francs, et admettre que les musulmans excitèrent et aidèrent les Basques. Ils n’ont pas mentionné dans leur récit le concours que ceux-ci leur avaient prêté, et d’autre part les historiens officiels de l’empire franc, qui présentent comme beaucoup plus heureuse qu’elle ne le fut l’expédition de Charles en Espagne, n’ont pas voulu avouer que les auteurs du désastre étaient, au moins en partie, les « Sarrasins », — censés alliés des Francs, — et que le roi n’avait pu même essayer de tirer vengeance de leur perfidie. Ils ont mieux aimé ne parler que d’une surprise des Basques, dont l’impunité, causée par leur dispersion dans leurs montagnes, n’infligeait pas à l’honneur franc une aussi sensible humiliation.
Quoi qu’il en soit, ce funeste événement affecta très péniblement le roi. Les Annales quasi officielles, rédigées peu de temps après, sans doute sous les yeux de Charles, terminent ainsi le récit du triste épisode : « Le souvenir de cette blessure effaça presque entièrement, dans le cœur du roi, la satisfaction des succès qu’il avait obtenus en Espagne. » On peut croire que cette phrase fut dictée à l’analyste par le roi lui-même : elle tranche, par sa note intime et personnelle, avec la sécheresse habituelle des Annales ; et quel autre que Charles aurait pu révéler ainsi les sentiments de son grand cœur ?
La douleur et la colère du roi furent partagées par son armée, puis, bientôt, par la nation tout entière. On conçoit que l’émotion ait été grande : ce qui surprend, c’est qu’elle ait été aussi durable, ait survécu pendant des siècles, et se soit propagée bien au-delà du pays où elle avait été ressentie. Le massacre d’un corps d’armée dans une embuscade n’est après tout qu’un fait de guerre comme il s’en produit souvent, comme l’histoire de tous les pays militaires, et celle de la France en particulier, en comptent par centaines. Combien, depuis lors, avons-nous essuyé de défaites plus sanglantes et surtout plus graves dans leurs conséquences ! Elles sont oubliées cependant, — sauf les plus récentes, — ou le souvenir n’en est conservé que dans les livres et n’émeut que les lecteurs français, il en est tout autrement de celle du 15 août 778. Le nom du lieu qui vit la fatale déroute, Roncevaux, en évoque jusqu’à aujourd’hui le funèbre souvenir dans les âmes. Le nom de Roland, — l’un des trois chefs mentionnés par Einhard parmi les victimes des Basques, — est encore populaire non seulement en France, mais dans l’Europe presque entière ; sa mort a fait verser des larmes à trente générations après celle qui l’avait connu ; son image a été dressée sous le porche des églises, peinte sur leurs murailles ou leurs verrières ; elle s’est élevée ou s’élève encore, symbole de justice et de liberté, sur la place publique de nombreuses villes saxonnes…
Comment s’expliquent cette survivance extraordinaire et cette propagation incomparable du souvenir d’un événement et d’un personnage qui semblaient ne devoir intéresser qu’une époque et qu’un pays ?
C’est que la France était alors en pleine activité épique : les événements ou les personnages qui frappaient l’imagination des hommes appartenant à la classe guerrière étaient aussitôt l’objet de chants qui, originaires d’un point quelconque, se répandaient promptement, grâce aux « jongleurs », — ces aèdes du moyen âge, — dans le tout entier, s’adaptaient aux dialectes divers, et s’accroissaient dans leur marche comme les ondes formées par un choc vont s’élargissant autour de leur centre. L’épopée française — qui avait commencé dès l’époque mérovingienne — fut en pleine vie jusque vers la fin du Xe siècle. Les nouveaux chants qui surgissaient sans cesse ne faisaient pas oublier les anciens quand ceux-ci, par quelque circonstance particulière, méritaient de survivre : une génération les transmettait à l’autre, en les renouvelant pour le langage, en les modifiant et les amplifiant avec plus ou moins de bonheur. La chanson de geste consacrée à Roland, — née sans doute dans la Bretagne française, dont il était comte, puis répandue par la France entière, — traversa ainsi toute l’époque carolingienne. Au XIe siècle, elle existait sous des formes diverses, toutes, naturellement, assez éloignées de la première. De deux de ces formes nous avons d’imparfaits représentants dans un roman latin (la chronique attribuée à l’archevêque Turpin) et un poème latin en mauvais vers. D’autres ont laissé des traces dans les allusions de quelques poèmes français ou italiens, La plus éloignée de l’original, entre celles dont nous pouvons nous faire une idée, est probablement celle qui fut fixée vers 1080 : c’est la Chanson de Roland que, malgré plus d’une incertitude, nous possédons à peu près telle qu’elle fut alors rédigée ; elle fut, vers la fin du XIIe siècle, l’objet d’un « renouvellement » où l’on substitua la rime à l’assonance. Grâce à l’incomparable ascendant qu’exerçaient alors sur tout le monde occidental la culture et la poésie françaises, la Chanson de Roland fut traduite ou adaptée partout : en Espagne, où elle suscita l’épopée nationale (cantares degesta) ; en Italie, où elle était populaire dès le XIe siècle, et où elle aboutit, par une étrange déviation, aux poèmes de Boiardo et d’Arioste ; en Angleterre, où elle a été mise en anglais et même en gallois ; en Allemagne, où elle fut traduite en vers dès 1133 ; dans les Pays-Bas, où elle a été plus d’une fois, et d’après diverses rédactions, imitée en prose et en vers ; en Scandinavie, où, mise en prose norvégienne au XIIIe siècle, elle fait l’objet de livrets restés populaires en Danemark et jusqu’en Islande.